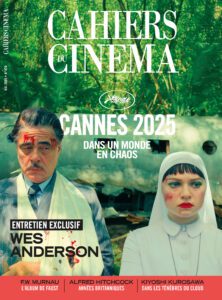De mal en pigeon
ActualitésCritique
Publié le 25 mars 2025 par
Aimer perdre de Harpo Guit, Lenny Guit (2025)
« Comment soigner » sont les mots qu’inscrit Armande, l’anti-héroïne d’Aimer perdre, dans la barre de recherche. Vif d’esprit, Google suggère la suite. Comment soigner quoi ? Une angine ? Un panaris ? Non : un pigeon. Celui qu’elle a recueilli alors qu’il stagnait au milieu de la route, placide, dépressif. Les noms de petits bobos s’affichant à l’écran éclairent tout de même l’allégorie : qui veut sauver autrui se retrouve surtout devant ses propres plaies, ses propres tares. Et l’oiseau de personnifier un double évident de la protagoniste – si évident que son nom complet est Armande Pigeon.
Harpo et Lenny Guit n’ont pas peur d’être littéraux, leur cinéma étant branché à un cerveau comico-épileptique qui se moque bien, à raison, de jouer au fin psychologue. Pas plus qu’ils n’ont peur de tirer sur des ficelles usées par d’autres – tels que les frères Safdie, influence revendiquée dont semble provenir l’ossature du récit. Combinarde bruxelloise vivant aux dépens des autres, parieuse fauchée et malchanceuse (logique), Armande croise le pigeon mais aussi Ronnie, sémillant échalas qui agit sur elle comme un portebonheur; formant un duo gagnant, ces flambeurs discount se jettent dans une frénétique virée nocturne entre casino et caniveau. Le pigeon convalescent comme métaphore du care que la joueuse néglige pour elle-même, en revanche, évoque moins les Safdie que Showing Up de Kelly Reichardt, où Michelle Williams soignait un colombidé. Influence bien plus lointaine, certes, mais Aimer perdre prolifère autour du même doute que suscite la lose au féminin chez Reichardt : de la baby-sitter pour animaux et de la société qui la regarde s’embourber dans ses problèmes, qui est le boulet ? Ce doute hante l’odyssée chancelante d’Armande, jalonnée d’enjeux prosaïques – lorsqu’on survit en comptant sur le hasard, le trivial est capital : un sandwich au camembert barboté dans un frigo se change en graal. Qu’il s’agisse de Catherine Ringer (logeuse maternelle au verbe haut), de Melvil Poupaud (noctambule cupide et crasseux comme pourrait en jouer Bouli Lanners) ou d’inconnus glanés dans le Bruxelles souterrain, les regards posés sur Armande sont duels. Tous trahissent un légitime agacement envers la tornade humaine qui joue de mauvais tours à son entourage ; en même temps, ils représentent l’austère jugement du destin qui s’abat injustement sur elle. Dès lors, le moteur qu’est la galère, déjà à l’œuvre dans Fils de plouc et réaffirmé ici comme système burlesque et motif obsessionnel (« C’est quoi, cette galère ? » est la première réplique), acquiert une dimension politique : la galérienne bouscule, salit, profite – mais la société en face fait pareil, comme ses ex et soupirants toujours prêts à monnayer en nature leurs dépannages.
La galère façon Guit ne suscite aucun apitoiement, mais une solidarité passant par une mise en scène accordée au défaut magnifique d’Armande : son énergie sourde et aveugle. Comme elle, Aimer perdre ne tient en place (modèle pour un cours de nu, elle est réprimandée car elle parle et frétille), tourne comiquement en rond (tels les aéromodélistes au nez en l’air, dont elle voudrait tirer profit), n’écoute rien des mises en garde (une comédie d’action aussi pauvre que l’héroïne : risqué, mais les auteurs tentent leur chance eux aussi) afin de mieux foncer bille en tête par-delà les conventions, avec le même regard de taureau que l’actrice Maria Cavalier-Bazan, révélation électrique dont la grâce hypernerveuse tranche finalement avec l’oiseau apathique du début. Avec ses lorgnades foudroyant autrui par en dessous, Maria/Armande se rend aimable et haïssable, gagnante et perdante, arnaqueuse arnaquée, si bien qu’elle brouille le regard : allez savoir qui est la vraie, le vrai pigeon(ne) de cette histoire.
Yal Sadat
Anciens Numéros