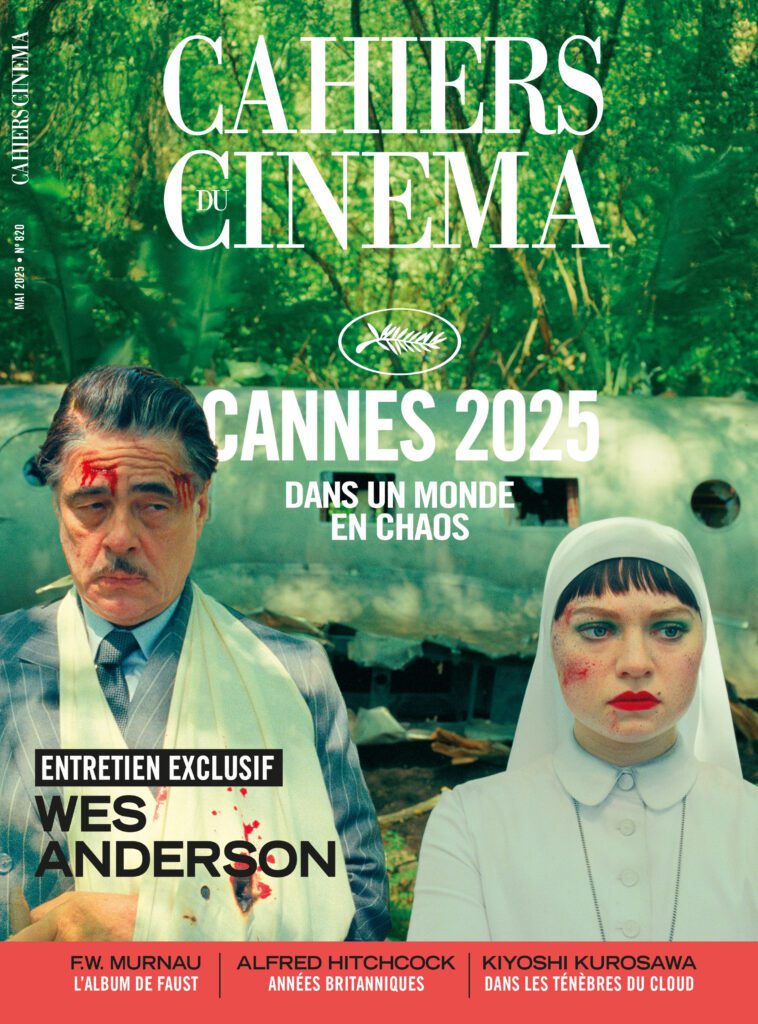Un métier comme les autres
Editos
Publié le 2 avril 2025 par
Le rapport de la Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode de la publicité, présidée par Sandrine Rousseau et dont le rapporteur est Erwan Balanant, a été présenté le 9 avril dernier. Lisible sur le site de l’Assemblée nationale, ce travail très fourni, fruit de 118 heures d’échanges avec 350 professionnels des secteurs concernés, constitue un document historique, pour de bonnes et de mauvaises raisons. On y trouve en effet les contradictions de la Commission elle-même : une volonté politique nécessaire mais qui semble parfois plus soumise au spectacle de la communication qu’à une rigueur méthodologique, un lieu de parole ouverte mais une partialité dans la réplique qui vire régulièrement au procès. Si le cas par cas des auditions est souvent contestable dans la façon d’y mener les débats (lorsque le jugement l’emporte sur l’écoute), on ne peut cependant qu’être d’accord avec le résumé des objectifs et constats où sont relevées des « défaillances systémiques » dont les principales causes sont « le statut précaire de la plupart des professionnels de ces secteurs », des « hiérarchies marquées », une « confusion permanente entre vie personnelle et vie professionnelle » et un « silence entretenu par la peur d’être blacklisté ».
Les professions de ces secteurs doivent-elles être considérées comme des métiers comme les autres et se soumettre aux mêmes précautions, devoirs et lois ? Il me semblerait nocif qu’une commission d’enquête parlementaire réponde autrement qu’affirmativement. Il s’agit ici d’abus dans des domaines où les rapports de pouvoir n’ont pas été assez pensés, notamment en termes de droit du travail. Cela rappelle le débat sur la convention collective du cinéma en 2014, dans laquelle une majorité de producteurs et de cinéastes craignaient qu’une réglementation rigide des salaires et des horaires nuise à une pratique libre de la création cinématographique. Une minorité défendait au contraire l’idée que « les droits des créateurs ne sont pas opposables au droit du travail ». Alain Guiraudie écrivait alors dans une lettre ouverte à la SRF : « Je trouve très prétentieux de penser que parce qu’on fait de l’art (ou parce qu’on croit en faire) on devrait faire passer sa condition “d’artiste” avant tout. » C’est aussi ce que nous inspire la liste des recommandations proposées par la Commission, incontestables dans leur manière de remettre en cause le système hiérarchique qui favorise les VHSS et entretient le silence des victimes : ces règles ne sont pas là pour intervenir dans la création mais pour garantir une égalité de droits et de protection dans le cadre d’un travail collectif.
Le seul métier qui n’est pas vraiment traité comme tel dans le dossier soumis à la presse le 9 avril est finalement celui de critique, dont la responsabilité est placée dans l’ordre du symbolique. Selon la seule phrase qui leur est consacrée, « les critiques sont des prêtres qui rendent un culte aux dieux ». Quiconque s’intéresse un tant soit peu à la critique, à son histoire, à sa pratique, à son statut intellectuel et social, comprendra combien cette affirmation signée Geneviève Sellier relève de la caricature. Que la commission la mette en exergue est d’autant plus triste que dans son résumé aucun autre métier du cinéma n’est ainsi réduit à une généralité insultante. Aucune phrase ne commence par « les réalisateurs sont… », « les acteurs sont… », « les directeurs de casting sont… », puisqu’il est question de pratiques et de conditions de travail concrètes, et heureusement pas de stigmatiser des professions. Le critique n’est pourtant pas un être symbolique, il produit, souvent dans des conditions précaires, des textes qui ne ressemblent que très rarement à des louanges ébahies ou à des prières illuminées (pour cela, voyez plutôt les hommages dont se gargarisent la télévision, les César et autres remises de médailles). Jusqu’ici, on avait plutôt tendance à nous reprocher le contraire, une prétendue méchanceté ! Mais puisque l’on nous traite de prêtres, alors soyons le curé de campagne de Bernanos : « C’est une des plus incompréhensibles disgrâces de l’homme, qu’il doive confier ce qu’il a de plus précieux à quelque chose d’aussi instable, d’aussi plastique, hélas, que le mot. »
Marcos Uzal
Anciens Numéros