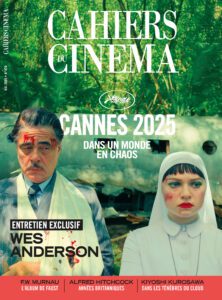Sûre mesure
ActualitésCritique
Publié le 3 avril 2025 par
Jeunesse (Les Tourments) de Wang Bing (2024)
On n’a peut-être jamais vu la première partie, ou saison (Le Printemps), de Jeunesse. On a peut-être rêvé l’avoir vue, puisqu’ici tout recommence, presque à l’identique. Retour aux ateliers textiles de Zhili, quartier environnant mais invisible, limité aux immeubles dans lesquels, de nouveau, la caméra de Wang Bing circule en vase clos, la moindre embardée dans la rue tenant de l’incursion périlleuse. Avec les lieux, reviennent leurs occupants, jeunes et moins jeunes ouvriers exilés des campagnes occidentales de la Chine : leur nom et leur âge se surimpriment toujours à l’écran, associés à leur village et province d’origine. Après le premier chapitre, qui s’achevait sur le retour d’un couple au pays, ces rappels toponymiques prennent toutefois une autre épaisseur, ils lorgnent vers une image latente, les lointains paysages que les travailleurs regagneront là encore, après un long confinement (plus de trois heures à l’écran, des mois dans la réalité). Puissants décrochages qui prouvent combien la longue durée est tout, chez le cinéaste, sauf une signature ou un « format » visé pour lui-même : ici, le montage des masses temporelles répercute le déphasage intime de l’exil.
Les Tourments apparaît en fait comme une séquelle du Printemps, une suite qui dégénère. Leurs structures se ressemblent tout comme se ressemblent les scènes de négociation de salaire, les gestes machinaux des ouvriers, les tissus pliés et repliés (le film s’ouvre sur une histoire d’ourlets), façon toile de Pénélope. Wang ne craint pas la redondance, parce qu’il ne considère pas, chose rare dans le documentaire, que le réel se réduise à un éventail de situations exemplaires. Il esquisse des portraits, traque ce qui varie dans l’invariable, l’accroc, le trou, l’événement. Or dans Les Tourments, les événements les plus graves sont invisibles. On y signale plusieurs disparitions : après le livret de paie d’un garçon désemparé, c’est au tour d’un patron endetté de s’évaporer dans la nature en ayant, au passage, tabassé un fournisseur. L’incident, qui éclate dans la rue, crée une sorte de dépressurisation, il aspire le tournage depuis le dehors : posté auprès des ouvriers, le cinéaste « rate » la scène, puis enregistre son infini après-coup, une cascade de déboires se perdant aux confins des jours et des nuits.
À côté des stratég ies de survie (revendre les machines pour se payer un minimum, plutôt qu’espérer un geste de l’État), le film documente alors le temps ahuri de l’abandon, du déboussolage. Le temps du débat moral existe, mais il est bref, le scandale se périmant vite dans un lieu où parler signifie ralentir, freiner la cadence : « Ça cause, mais faut bosser aussi », souffle-t-on en coulisses. Menacent donc l’effritement de la colère, l’accoutumance à la marche des choses. On apprend que les fuites de patrons ne sont pas rares. L’événement s’effiloche, reflue à l’état d’anecdote. La concurrence au sein d’un même atelier étouffe la possibilité d’une grève. C’est le moment que Wang Bing choisit pour créer un contrepoint minuscule et implacable. Au bord de l’inertie, il perce un trou, mais dans le dispositif : alité dans le noir, un homme lui parle directement, un peu comme le faisait Fengming, survivante des camps de travail, dans Fengming, chronique d’une femme chinoise (2007). Il lui raconte la révolte du quartier en 2011 lors de la mise en place d’une taxe, puis la répression policière, brutale, lancée contre les travailleurs migrants. L’irruption calme, presque rieuse, de ce témoin nocturne est aussi inattendue que les feux d’artifices allumés par un père fêtant le retour de son fils à la campagne : ainsi la « vitalité extraordinaire » des sujets filmés, saluée par le cinéaste dans un carton final, paraît-elle d’autant plus surprenante lorsqu’elle surgit, infime et pétaradante, au détour d’un plan-séquence.
Élie Raufaste
Anciens Numéros