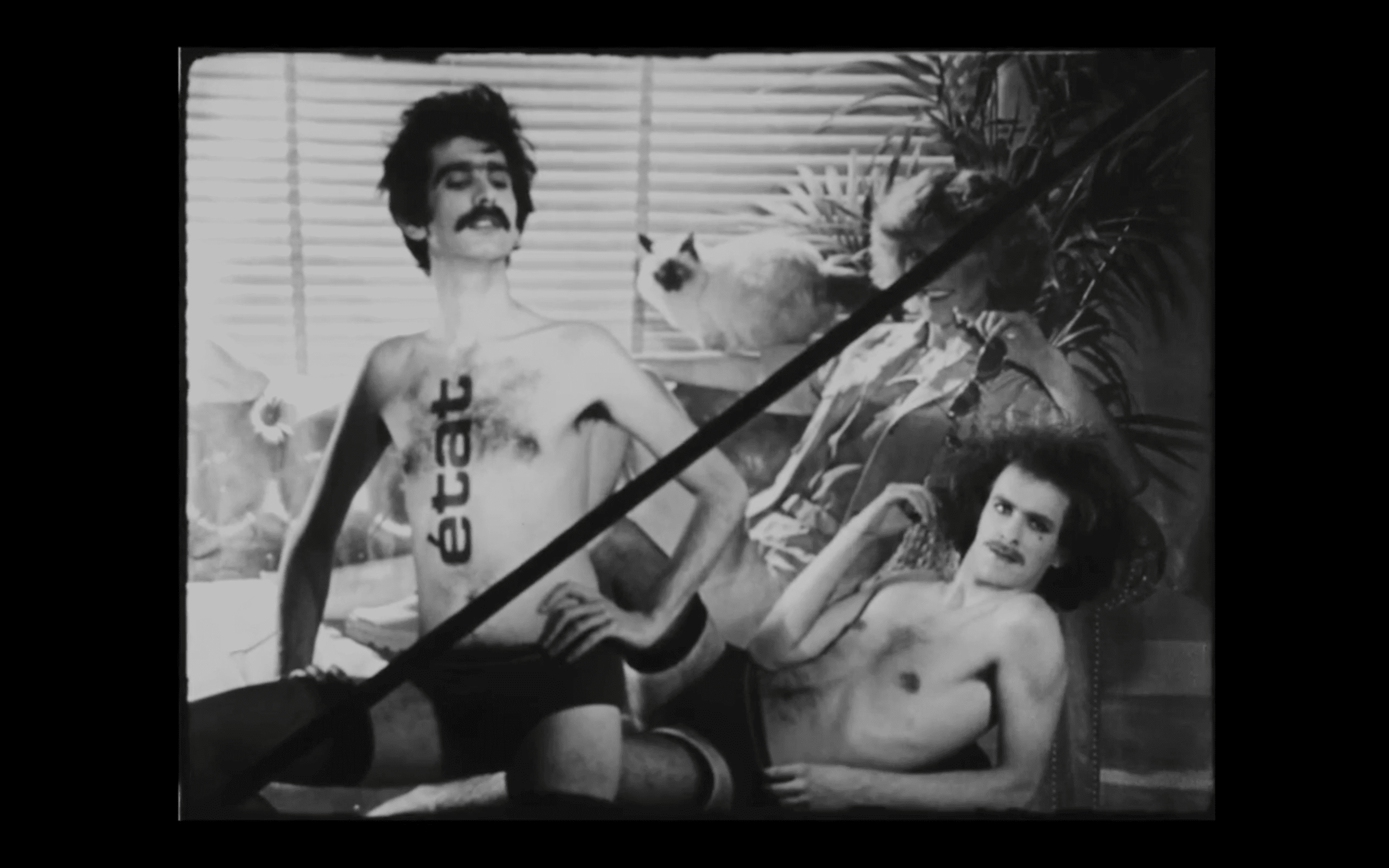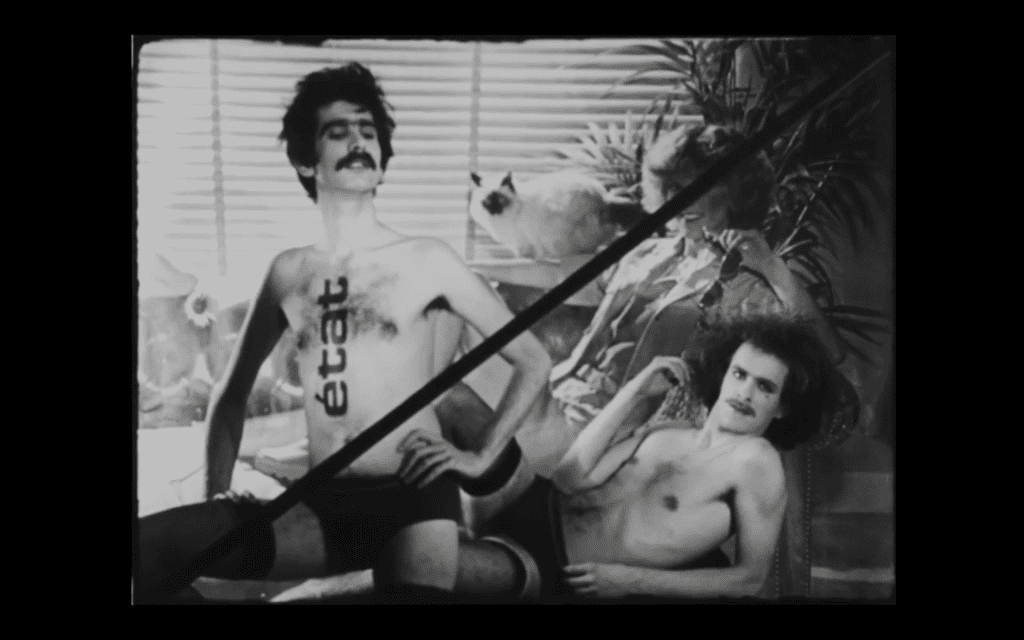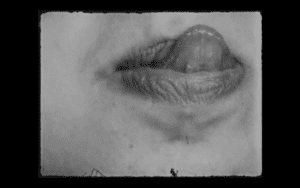Alice LeroyDes caméras aux mains de la police
Le Conseil constitutionnel a censuré hier quatre articles de la loi “Sécurité globale”, notamment ceux portant sur la diffusion des images de policiers (le très médiatisé article 24) et l’utilisation de drones ou de caméras véhiculées (…)
Nous republions le texte de Fernando Ganzo et Alice Leroy datant de juillet 2020 qui, autour de l’article 24, interrogeait la captation militante et citoyenne des violences policières dans un contexte de plus en plus marqué par la monopolisation des images par le pouvoir.
Les inquiétudes détaillées par ce texte restent d’actualité après ce qui ne s’apparente qu’à une demi victoire : car le Conseil n’a pas censuré d’autres articles aux thématiques proches, par exemple l’extension à la police municipale de l’accès en temps réel aux images de vidéosurveillance dans les transports, les halls d’immeuble ou les caméras-piétons.
Voir aussi les publications de la Coordination Stop Sécurité Globale autour du texte et des conclusions du Conseil constitutionnel : https://twitter.com/coordostoploisg?s=11
Des images du meurtre de George Floyd à Minneapolis à la proposition de loi Ciotti visant à interdire la diffusion des vidéos filmant les policiers français, une histoire contemporaine du rapport des images et des violences policières semble s’écrire sous nos yeux, tandis qu’un mouvement mondial dénonce ces violences et leur caractère raciste.
Le 26 mai dernier, le député LR Éric Ciotti déposait une proposition de loi à l’Assemblée nationale visant à interdire « la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de policiers municipaux ou d’agents des douanes » sous peine d’une condamnation à 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement. Reprenant une revendication des syndicats de police, cette mesure serait justifiée par la nécessité de protéger l’anonymat des forces de l’ordre dans l’espace médiatique, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. La veille, le 25 mai 2020, à Minneapolis, George Floyd étais assassiné, étouffé par trois policiers l’ayant plaqué au sol, un genou appuyé sur sa nuque durant les huit minutes et quarante-six secondes de son agonie. La scène, filmée par des passants et les caméras de surveillance des commerces alentour, était retransmise en direct sur un Facebook Live par une adolescente, Darnella Frazier. Elle allait déclencher un mouvement de protestation national puis international, s’étendant comme une trainée de poudre à toutes les villes américaines avant de gagner l’Europe. On n’ose imaginer quel syllogisme douteux pourrait relier ces deux évènements de part et d’autre de l’Amérique : si Daniella Frazier n’avait pas filmé la scène avec son téléphone portable ce jour-là, le nom de George Floyd ne serait pas devenu l’emblème d’une mobilisation mondiale contre les violences policières et sa mort serait restée dans le silence des quelque mille personnes, parmi lesquelles une effrayante proportion d’Afro-Américains, tuées chaque années par la police américaine. Au début des années 2000, les dashcams, ces caméras embarquées à bord des véhicules, ont commencé à équiper massivement les voitures de police américaines (11% en disposaient en 2000 et 72% en 2003). Dans un premier temps, ce dispositif fut présenté aux agents des forces de l’ordre comme une sorte de bouclier : en plus de pouvoir éventuellement les exonérer en cas de litige, il était censé produire un effet dissuasif chez les personnes interpellées susceptibles d’opposer une résistance. Or la mise en ligne des images tournées par les dashcams suscita bientôt une réaction que le département de la justice des États-unis n’avait pas anticipée : l’indignation face aux discriminations et violences subies par les populations noires, plus souvent interpellées et plus souvent victimes de bavures. Dans certaines villes, comme Chicago, le nombre de dashcams en panne ou non opérationnelle a depuis augmenté de manière suspecte. Loin d’agir comme une instance de médiation neutre, encore moins de garantir la légalité des actes des forces de l’ordre, la caméra s’est retournée contre son opérateur, en objectivant une tension raciale que la promesse de l’ère Obama n’a pas su apaiser ni dissimuler.
À une époque où l’acte de sortir son smartphone quand on est témoin d’un acte de violence est presque devenu un réflexe, l’image détermine une nouvelle zone d’affrontements contre l’arbitraire des lois. Fondé part trois femmes en 2013 après la mort du jeune Trayvon Martin à Sanford en Floride et l’acquittement de son assassin, le vigilante Georges Zimmerman, le collectif Black Lives Matter réclame justice pour les victimes des policiers (Michael Brown à Ferguson en 2014, Eric Garner à New York et Freddie Gray à Baltimore en 2015…) images à l’appui. A priori incontestables, ces vidéos réalisées par des témoins font pourtant rarement condamner un membre des forces de l’ordre. Il faut remonter à l’affaire Rodney King pour comprendre pourquoi. Le 3 mars 1991 cet Afro-Américain est passé à tabac par des policiers de Los Angeles. Les images granuleuses de la vidéo prise par un témoin de la scène sont accablantes. produites lors du procès des officiers incriminés, elles ne réussiront pas à empêcher leur acquittement.
C’est qu’une image ne parle jamais pour elle-même. Elle est prise dans des lectures contradictoires, même aberrantes, dépendant du contexte de sa réalisation et de sa diffusion. En l’occurrence, les avocats de la défense se livrèrent à un improbable exercice d’analyse d’images, réinterprétant et contestant chaque plan de la bande vidéo de manière à corroborer la version des policiers et à dépeindre King en colosse enragé. Ce que nous apprend l’affaire Rodney King, c’est donc, pour reprendre le mot fameux de Chris Marker, « qu’on ne sait jamais ce qu’on filme », et qu’on ne sait jamais non plus comment ni à quelles fins ces images seront perçues et utiliser sur un réseau social ou dans une cour de justice. Ces enjeux d’interprétation sont tels que, le 9 juin dernier, quelques jours après la diffusion massive des d’une vidéo montrant un manifestant de 75 ans dans la ville de Buffalo renversé par deux policiers et laissé sans secours dans une mare de sang, Donald Trump tweetait que la vidéo n’incriminait nullement les policiers, mais au contraire l’homme, qui semblait « tomber plus durement qu’il n’avait été poussé ». le président américain allait jusqu’à suggérer que le manifestant aurait en fait piégé les policiers et mis en scène sa propre agression en agissant au service d’un mouvement antifasciste que Trump a tenté depuis de requalifier en groupe terroriste. Pendant une année, dans la ville de Rialto (Californie), les agents avaient dû s’équiper de « body-worn cameras », des petites caméras fixées à leur torses. Le nombre de violences lors d’interpellations dans cette villes avait alors chuté de soixante-cinq à vingt-cinq pour une année. Plusieurs Etats ont depuis adopté ce dispositif et les projets de lois pour régulariser ou restreindre l’accès du public à ces enregistrements provoquent en ce moment un vif débat dans le pays. En passant des voitures aux corps des agents, les caméras ont pourtant brisé un peu plus ce prétendu « bouclier d’objectivité ». En France, par exemple, lors de l’acte III des Gilets Jaunes, le 1er décembre 2018, une unité de CRS équipée de caméras portées se retrouvait piégée par des manifestants près de l’Arc du Triomphe. Basculement du point de vue et esthétique du riot porn, l’image fait le tour des JT et des chaines d’information en continu et vient soutenir un autre récit, celui, bien rôdé, de la fureur populaire et de la foule émeutière. L’effrayante comptabilité des blessés et mutilés pendant les manifestations de Gilets Jaunes tenue, images à l’appui, par des collectifs tels que Désarmons-les ou le journaliste David Dufresne, se trouve ainsi contestée par des images non cadrées, en grand angle et à « hauteur de CRS », singularisant une force anonyme. Pire, encore, observe l’éditorialiste Fahard Manjoo dans l’édition du New York Times du 3 juin dernier à propos des récentes manifestations aux États-Unis, ces images érigent la violence en spectacle. Si la vidéo de la mort de George Floyd a déclenché une telle colère à travers le monde, ce n’est pas simplement parce qu’elle intervient dans un contexte de pandémie mondiale qui a fait saillir, particulièrement aux Etats-Unis, les inégalités sociales et communautaires. ce n’est pas non plus à cause de la violence qui s’y déploie (des vidéos similaires ont tristement circulé par le passé). Peut-être est-ce dû à l’indifférence obscène des policiers face aux caméras. Derek Chauvin, l’homme qui appuie son genou sur la nuque de George Floyd, sait pertinemment qu’il est filmé; il regarde à plusieurs reprises en direction de la caméra de Darnella Frazier, sa main fouillant sa poche, son torse redressé lui donnant presque l’air d’un chasseur posant auprès de sa proie abattue. Il n’a cure des témoins de la scène qui le pressent d’épargner sa victime, et le fait d’être filmé n’a pas l’air de le contrarier – il porte d’ailleurs lui-même- l’une de ces petites « body-worn cameras » dont le contenu n’a pas encore été dévoilé. Un autre officier présent sur les lieux, Tou Thao, essaie de calmer les esprits en répétant que tout va bien. Là est l’obscénité de ces images : dans cette mise en scène insupportable, assuré par des agents qui non seulement se savent filmés, mais agissent consciemment pour la caméra. Ce qui éclate à la surface du plan, c’est l’absence de honte, l’indifférence, presque l’ennui des policiers, tout juste agacés d’être invectivés par le petit attroupement autour. En 2005, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub avaient eux aussi invoqué une image manquante : celle de Bouna et Zyed, deux adolescents poursuivis par la police le 27 octobre de la même année, qui s’étaient réfugiés dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois où ils avaient péri brûlés vifs. Dès le lendemain, des émeutes historiques embrasaient les banlieues. Dans leur film Europa 2005 – 27 octobre, des vues panoramiques du transformateur sont ponctuées de « chambre à gaz », « chaise électrique ». Ces intertitres n’ont pas vocation à combler une absence mais à la signaler. Car là où les caméras n’étaient pas, le cinéma peut faire advenir une image, une parole, une mémoire. À l’inverse, la saturation du visible dans les mobilisations actuelles ne produit pas plus de lisibilité des évènements. À New York, lors des mobilisations de juin, on a vu des policiers sans armes, l’uniforme marqué du sigle de la brigade « Technical Assistance Response Unit » (TARU), suivre les interventions de leurs collègues caméra au poing. Quelle est la fonction de ces images ? Témoigner de la légalité des actions des forces de l’ordre ? Contrer les images des médias et des manifestants ? Ou bien contribuer à renforcer et contrôler un tissu du tout-image qui empêche justement ces interstices où le cinéma sait être un outil de dénonciation ?
En France, l’actualité récente nous a donné un avant-goût de ce monopole de l’image : l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dans la nuit du 8 au 9 avril 2018 s’est faite à l’abri des regards, certains journalistes se voyant refuser l’accès à la zone d’intervention afin de “ne pas gêner les manoeuvres” pour être dirigés vers un « espace presse » où un service image de la gendarmerie tenait « à disposition des rédactions des photos et vidéos de l’opération libres de droits ». En 2016 déjà, lors des manifestations contre la Loi travail, le service de communication de la Préfecture de Police proposait des images aux journalistes pour les tenir à l’écart de la mobilisation pour leur propre sécurité. Or s’il revient au pouvoir d’assurer la légitimité de ses actes, il ne saurait alors se trouver derrière la caméra. Si les vastes mobilisations actuelles dénoncent le monopole de la violence « légitime » de la police, l’État peut-il y répondre en établissant un autre monopole, celui des images de cette violence ?
Fernando Ganzo
Article à retrouver dans le n° : 767
Page : 68
par Fernando Ganzo