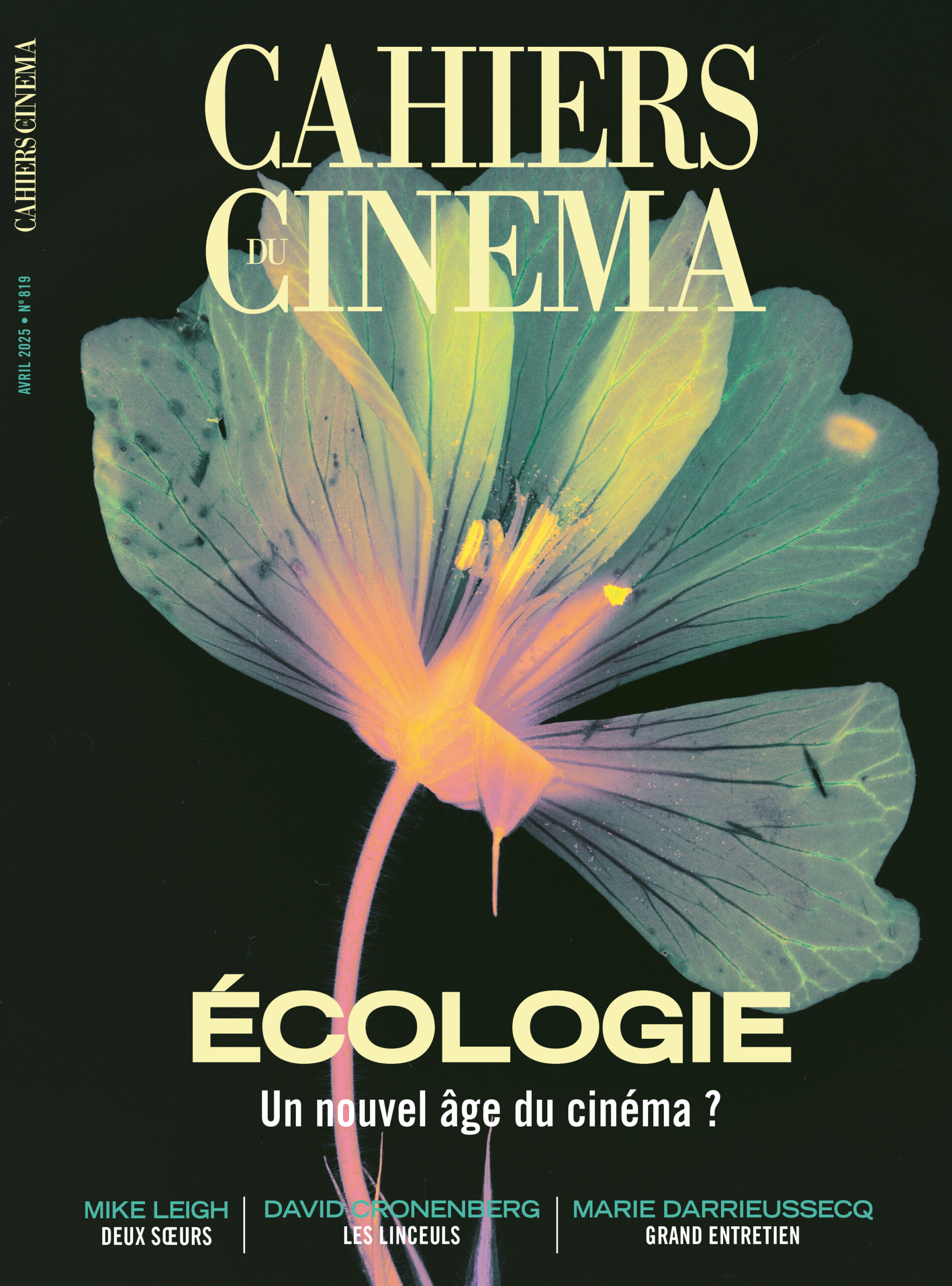ActualitésPour une culture du débat
Entretien avec Agnès Tricoire
Avocate spécialiste en propriété intellectuelle, Agnès Tricoire préside l’Observatoire de la liberté de création, fondé sous l’égide de la Ligue des droits de l’Homme et devenu récemment une association, « lieu de discussion interdisciplinaire et de solidarité entre tous les genres culturels ».
Le Manifeste de l’Observatoire de la liberté de création (2003) rappelle que « l’œuvre d’art, qu’elle travaille les mots, les sons ou les images, est toujours de l’ordre de la représentation. Elle impose donc par nature une distanciation qui permet de l’accueillir sans la confondre avec la réalité¹. » En quoi la décision ou non d’accompagner la projection d’un film d’un débat recoupe-t-elle aujourd’hui les questions de droit que l’Observatoire met en avant depuis sa création en 2003 ?
Quand j’ai proposé à Michel Tubiana, en 2002, de créer l’Observatoire, sous l’égide la LDH, c’était à une période de résurgence de demandes de la censure. Jusque-là, on connaissait les associations d’extrême droite, comme l’Agrif, qui perdait tous ses recours en condamnation contre les œuvres. Le début des années 2000 marque le retour de la demande de censure plus large, contre l’exposition « Présumés innocents » au CAPC de Bordeaux et deux livres accusés d’apologie de la pédophilie, Il entrerait dans la légende de Louis Skorecki et Rose bonbon de Nicolas Jones-Gorlin. Plus tard, avec les manifestations organisées contre l’exposition/tableau vivant Exhibit B au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, on peut considérer que des organisations défendant pourtant des causes progressistes ont emboîté le pas. À l’Observatoire, nous venons tous de disciplines différentes, et nous avons pris le temps de nous mettre d’accord sur les mots pour rédiger notre manifeste de 2003. À l’époque, la liberté de création n’existait pas en tant que telle. Nous y posons la distinction entre fiction et discours réel, et la nécessité, si une œuvre est contestée ou pose problème, d’organiser un débat avec son public.
Qu’en est-il des lois et de la jurisprudence récentes, et de leurs conséquences sur la création ?
La jurisprudence s’est inspirée de notre Manifeste pour distinguer entre fiction et réalité, distinction aujourd’hui bien établie. Nous sommes aussi à l’origine de la loi de juillet 2016 qui protège la liberté de création, de diffusion et de programmation. Le Conseil d’État, pendant le Covid, a décidé que ces libertés de création et de diffusion étaient fondamentales. Pour nous, c’est une victoire supplémentaire. Ces libertés relèvent de la liberté d’expression mais avec les spécificités de la fiction, donc avec leurs particularités; et les sénatrices, quand elles ont travaillé à évaluer cette loi, nous ont interrogés, et à cette occasion nous avons produit une note conséquente, que nous publierons sur notre futur site, qui retrace le paysage législatif concernant les œuvres et formule des demandes d’amélioration de la loi, encore trop restrictive. En parallèle, avec l’éditeur Actes Sud, nous contestons un arrêté de Gérard Darmanin qui a interdit un ouvrage destiné aux ados pour « pornographie », ce qui nous a permis de déposer (via l’éditeur et la LDH) à la fois un recours et une question prioritaire de constitutionalité. En effet, la loi de 1949, permettant de surveiller toute la littérature sous l’égide du ministère de l’Intérieur, qui peut prononcer l’interdiction de la vente et/ou de la publicité des livres, n’est pas conforme aux standards de la liberté d’expression tels que posés par l’article 10 de la CEDH et la jurisprudence de la cour de Strasbourg. Sous François Hollande, nous avons dû intervenir en urgence pour contrer un décret catastrophique donnant les clefs de la censure au cinéma à l’extrême droite. L’association Promouvoir, dirigée par un type qui s’était fait virer du FN par Bruno Mégret pour radicalité, fait des recours fréquents contre les visas pour obtenir un durcissement du classement des films qui ne lui conviennent pas, et y parvient depuis le début des années 2000 (Baise-moi et le rétablissement du moins de 18 ans). C’est ainsi qu’a subi cette interdiction, de façon absurde, Quand l’embryon part braconner de Kôji Wakamatsu, au propos progressiste, très beau film sur une femme qui se rebelle contre le joug qu’elle subit. Face à ces mouvements régressifs, la profession du cinéma, vu les importants enjeux d’argent, essaie d’anticiper, ce qui crée de l’autocensure en amont; cela s’accompagne aussi d’une profonde modification de ce qui est diffusé à la télévision, donc d’un appauvrissement culturel sous couvert de protection de l’enfance.
C’est pour éviter la censure que vous avez envoyé une lettre le 13 décembre au directeur de la Cinémathèque, Frédéric Bonnaud, lui demandant un débat contradictoire après la projection du Dernier Tango à Paris ?
C’était une offre qu’ils auraient dû saisir : nous proposions de coorganiser le débat. J’avais approché Frédéric Bonnaud, sans qu’il ne donne suite, il y a quelques mois. Là, il s’agissait, dans l’urgence, d’une proposition d’animer l’échange en tant qu’Observatoire, ce qui aurait permis aux personnes représentant la Cinémathèque d’être en égalité de terrain avec les gens qui protestaient contre la projection. L’idée est que chacun doit apprendre de l’autre. Les positions de surplomb qui s’abritent derrière des positions purement esthétiques se heurtent à celles qui contestent la programmation des œuvres pour des raisons purement sociétales et ça donne un résultat qui nous semble désastreux et qu’on avait anticipé dans la lettre : ils ont déprogrammé. Parce qu’ils n’ont pas mis la locomotive avant les wagons: diffuser Le Dernier Tango à Paris avec tout ce qu’on sait sur ce qui s’est passé pendant le tournage imposait de faire un débat public permettant enfin qu’un échange ait lieu.
Pourquoi proposer vous-mêmes d’organiser ce débat ?
Parce que nous avons l’expérience du débat et de ses difficultés, et regrettons que, de façon générale, les institutions culturelles n’en aient pas plus l’habitude. Nous savons qu’il faut être fort depuis Exhibit B, où la préfecture décourageait le Théâtre Gérard-Philipe d’organiser un débat pour des raisons d’ordre public. Devant le théâtre, des gens manifestaient (certains avaient cassé la porte dès le premier soir) et le public se faisait insulter… On a été présents tous les soirs pour faire de la médiation avec le public afin que les gens puissent échanger et parler dans ce contexte de violence, et que ceux qui avaient souhaité aller voir le travail de Brett Bayley puissent exprimer ce qu’ils avaient ressenti, en négatif ou en positif. J’avais fait venir des gens qui étaient pour la censure au départ, notamment deux associations s’occupant de la mémoire de l’esclavage aux Antilles, qui ont tout à fait changé de point de vue après avoir vu le spectacle. C’était d’ailleurs un moment émouvant, qui a été précédé d’un long silence, car la visite avait fait remonter des choses extrêmement douloureuses. Le visiteur qui était le plus remonté a priori m’a demandé à la fin si on ne pouvait pas œuvrer à ce que le tableau vivant soit filmé, pour que tout le monde puisse le voir. Ça nous a appris beaucoup, même si on le sait, au fond: les œuvres sont souvent victimes de préjugés. Il est donc essentiel que le débat ait lieu après la prise de connaissance de l’œuvre.
Cette posture privilégiant un échange après avoir vu l’œuvre est-elle contestée dans certains secteurs ?
Il y a des intellectuel·l·es militant·e·s qui soutiennent que le public de l’œuvre est aussi celui qui la conteste sans l’avoir vue. La réponse pour nous, c’est que le public d’une œuvre est celui qui l’a vue et qui peut en discuter.
Cela pourrait-il aussi s’appliquer au cas du Dernier Tango à Paris ?
Ce cas pose une question spécifique, car d’une certaine façon les contestataires de la diffusion de l’œuvre peuvent répondre: on sait déjà ce qu’il y a dedans, on est déjà informé·e·s par les prises de position publiques de Maria Schneider sur ce qu’elle a subi. C’est aussi un débat spécifique car le film ne pose pas seulement problème à cause de son contenu (montrer un viol, que certains considèrent d’ailleurs comme un viol réel alors qu’il reste fictif) mais aussi à cause de la façon dont il a été réalisé et du dommage qui a été fait à son actrice. Pour Exhibit B, aucun comédien ne s’est plaint de ce que des activistes reprochaient à l’œuvre, à savoir que les comédiens auraient été silenciés, car seul leur regard était mis en scène. À la fin de l’installation, il y avait même des textes des comédiens expliquant pourquoi ils avaient voulu participer à cette œuvre. Alors que Maria Schneider, qui n’est plus là pour raconter les choses, a clairement décrit la scène comme un viol symbolique.
Un des arguments pour ne pas le montrer, ou le voir, est qu’une violence effective est là, à l’écran.
Oui, mais le choix de mots n’est pas anodin. On ne peut pas dire que c’est un viol filmé, car l’actrice n’a jamais dit qu’elle a été violée réellement. Mais elle a évoqué la violence qu’elle a subie dans la scène, et on sait que son consentement n’a pas été recueilli pour le tournage d’une scène de viol.
Vous insistez sur l’importance des échanges après avoir vu les œuvres. Dans le cas du cinéma et des séries, il y a aussi une vraie demande d’avertissement: que le spectateur soit prévenu si ce qu’il va voir peut le heurter, une sorte de première contextualisation. Mais comment proposer ces trigger warnings sans que ces informations préalables ne conditionnent le spectateur à accepter ce qu’il va voir, même si ça le heurte, sans le contester ou le mettre en question dans l’échange qui aurait lieu à la fin de la séance ?
Des éléments objectifs de contextualisation factuelle peuvent être donnés avant la séance. Je ne vois pas en quoi ça pourrait rendre le spectateur plus docile, au contraire, cela lui permet de prendre de la distance par rapport à ce qu’il va voir. Mais il faut être très vigilant, et éviter de confondre information et positions de jugement. C’est une question extrêmement complexe dont on n’a pas encore vraiment discuté à l’Observatoire : celle de l’information. Si l’information est nécessaire avant Le Dernier Tango à Paris, de façon évidente, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de la précaution systématique, et se croire obligé de prévenir les spectateurs qu’il y a des scènes « dérangeantes » dans un film. Les œuvres d’art sont aussi là pour nous déranger.
Le fait que la Cinémathèque ait une mission de service public importe-t-il dans la demande que vous lui avez adressée ?
Oui, la lettre le stipule. La Cinémathèque est une association qui vit sur des fonds publics et a des missions de service public. On peut légitimement envisager que l’accompagnement des spectateurs est une nécessité, et qu’une prise de parole purement esthétique quand une œuvre pose un problème qui dépasse l’esthétique n’est pas suffisante.
Il semble y avoir une difficulté à établir un pont entre analyse esthétique et analyse politique, ce qui rend difficile les échanges entre une cinéphilie pure et dure et des secteurs plus militants.
Vous avez raison et notre démarche vis-à-vis de la Cinémathèque l’a prouvé jusqu’à l’absurde. La difficulté vient de postures radicales qui refusent la discussion a priori, l’une purement esthétique de la part des organisateurs, et l’autre militante qui consiste à dire « il n’y a pas de débat à avoir parce qu’il n’y a pas de projection à avoir ». Tout le monde ne partage pas, du côté féministe, cette position. On aurait sans difficultés trouvé des points de vue différents pour un débat passionnant.
La Cinémathèque vous a-t-elle répondu ?
Pas du tout. Frédéric Bonnaud n’est évidemment pas tenu de nous répondre, mais on peut déplorer ce silence alors que la Cinémathèque elle-même, dès lors qu’elle a décidé de programmer le film sans rien organiser autour, s’était tiré une balle dans le pied. Il était évident que tout cela aboutirait à une déprogrammation, décision que la Cinémathèque a prise pour des raisons que je n’ai pas très bien comprises, d’ailleurs, de sécurité, comme si les féministes étaient de dangereuses agitatrices…
Plus généralement, quels critères relatifs à un film font à vos yeux que sa projection exige un débat? Est-ce lié à des réactions extérieures ?
Organiser des débats existe déjà, pour un tas de raisons: faire venir l’équipe racontant la genèse, pour des raisons esthétiques ou militantes. Du côté militant, je l’ai souvent constaté, il y a peut-être eu un glissement qui a fait que l’on s’est habitué à organiser des séances sur des documentaires uniquement autour de leur sujet, donc à dissocier le politique de l’esthétique, ce qui est dommage : je suis convaincue que la forme est politique. Aider le public à comprendre l’œuvre et la façon dont elle est faite l’aide aussi à réfléchir la question militante. Parler aussi d’hors-champ, de travellings, dont on sait qu’ils posent des questions éthiques au cinéma, serait plus enrichissant pour tout le monde.
Pensez-vous que le mot « censure » a pris aujourd’hui un sens nouveau, ou qu’il est utilisé de manière abusive ?
En tant qu’intervenante à l’université depuis plusieurs années, je remarque qu’aujourd’hui la censure est en partie considérée comme souhaitable, alors qu’avant, tous les progressistes étaient d’accord pour lutter contre. Actuellement, quand vous demandez à un panel de gens, y compris ceux qui travaillent dans la culture, quelles raisons légitiment la censure,comme je l’ai souvent fait en cours et en formation continue, ils trouvent tous une « bonne » raison, qu’elle soit féministe, religieuse, politique, historique… Le mot est rejeté par les associations progressistes qui disent: « la censure est l’apanage de l’État, nous, on demande l’annulation. » Mais cette pression pour que l’œuvre ne soit pas montrée, c’est de l’entrave, nouvelle forme de censure.
Pour le cinéma, n’importe qui peut voir le film ailleurs, en raison de la reproductibilité technique des copies, ce qui amoindrit la gravité de la demande d’annuler une projection.
Cette objection ne marche pas, parce que certes, un tableau est une œuvre unique, mais interrompre ou rendre impossible une séance de cinéma reste de l’entrave à la diffusion. À l’Observatoire, nous sommes d’ailleurs en train de travailler à cette question du délit d’entrave et de ses conditions avec les sénatrices qui sont à l’origine de la loi de 2016. Cette loi que l’Observatoire a contribué à forger est très importante car elle protège la liberté de création et de diffusion des œuvres ; elle a introduit le délit d’entrave dans le code pénal. Les atteintes aux œuvres se sont démultipliées, du simple courrier d’une association à un programmateur public dépendant d’un maire qui fait obstacle, ou encore au vandalisme. Au cinéma, c’est dur de vandaliser les copies, mais en art contemporain, c’est presque un sport.
Un des reproches faits à la Cinémathèque serait qu’en projetant Le Dernier Tango elle lui accorde une « place d’honneur ».
Il faut relire les statuts de la Cinémathèque : elle est censée acquérir tous les films qui marquent l’histoire du cinéma, or les critères, c’est une question toujours discutable. Est-ce que la Cinémathèque revendique de diffuser les films mauvais ou mineurs? Elle joue elle-même le jeu de l’institutionnalisation, dans la manière dont elle présente sa programmation. Mais de façon plus générale, ce n’est pas parce que l’on montre qu’on approuve ou que l’on honore. Cette distinction est essentielle, on devrait y revenir, et montrer des films aussi pour leur aspect problématique, y compris esthétique.
Cette question de la place d’honneur s’est posée pour la rétrospective Roman Polanski.
La différence est que Polanski est vivant et était invité en personne. Mais je suis gênée par cet argument de l’honneur: certes, tout le monde a envie d’avoir une rétrospective à la Cinémathèque, mais cela ne suffit pas à disqualifier la projection.
Pensez-vous qu’il importe encore de faire la distinction entre l’œuvre et l’auteur, distinction désormais souvent moquée pour pointer la mauvaise foi des partisans d’une « politique des auteurs » légitimant des abus ?
Pour répondre à cette question, je me permets de citer ce que j’avais écrit dans les pages du Monde: « Prétendre que le même corps filme et viole, c’est l’argument déjà utilisé par certaines féministes contre le J’accuse de Polanski, pour en demander la déprogrammation. Or, il ne vaudrait que si l’œuvre montrait le crime dont l’auteur est accusé, et alors en effet sa diffusion serait très discutable. En dehors de cette hypothèse, chacun doit pouvoir juger s’il est opportun, pour soi, de voir les films des auteurs mis en cause. Enfin, les déviances de certains ne doivent certainement pas abolir de façon générale la distinction entre l’auteur et l’œuvre, nécessaire pour lutter contre la censure ou l’entrave à la diffusion des œuvres.² »
¹ «Manifeste de l’Observatoire de la liberté de création» (28/02/2003) disponible sur le site de la Ligue des droits de l’Homme, ldh-France.org.
² Tribune parue dans Le Monde (30/03/2024) et reproduite sur le site de la LDH, ldh-France.org.
Entretien réalisé par Fernando Ganzo, Charlotte Garson et Marcos Uzal par téléphone, le 14 janvier
par La rédaction