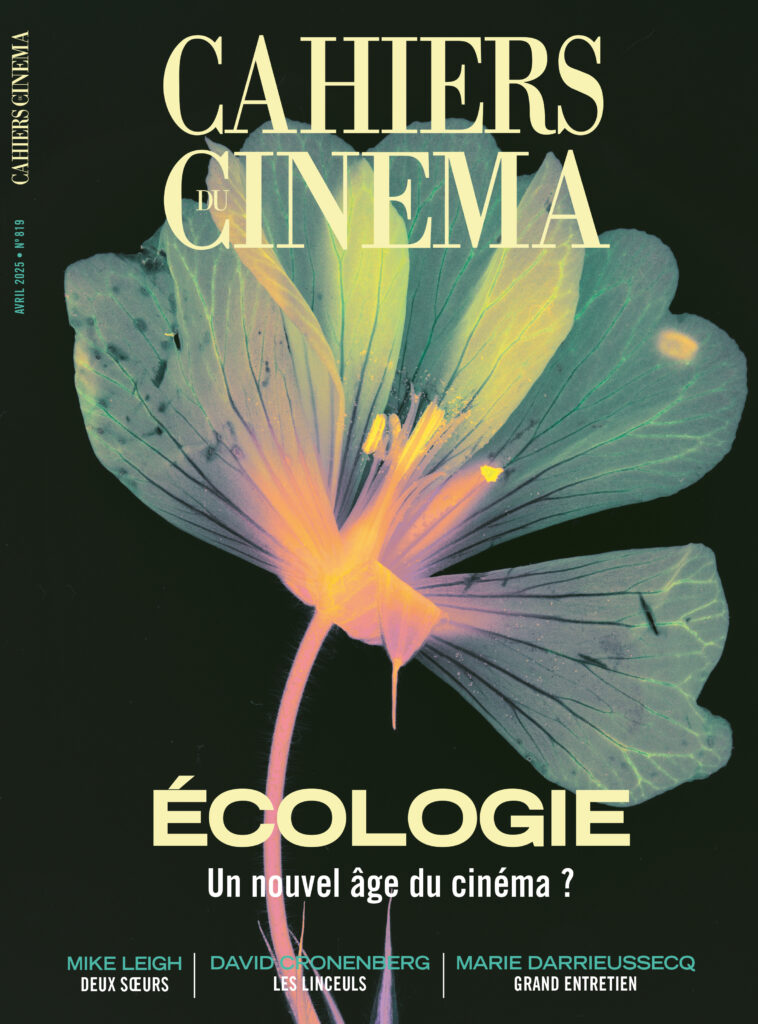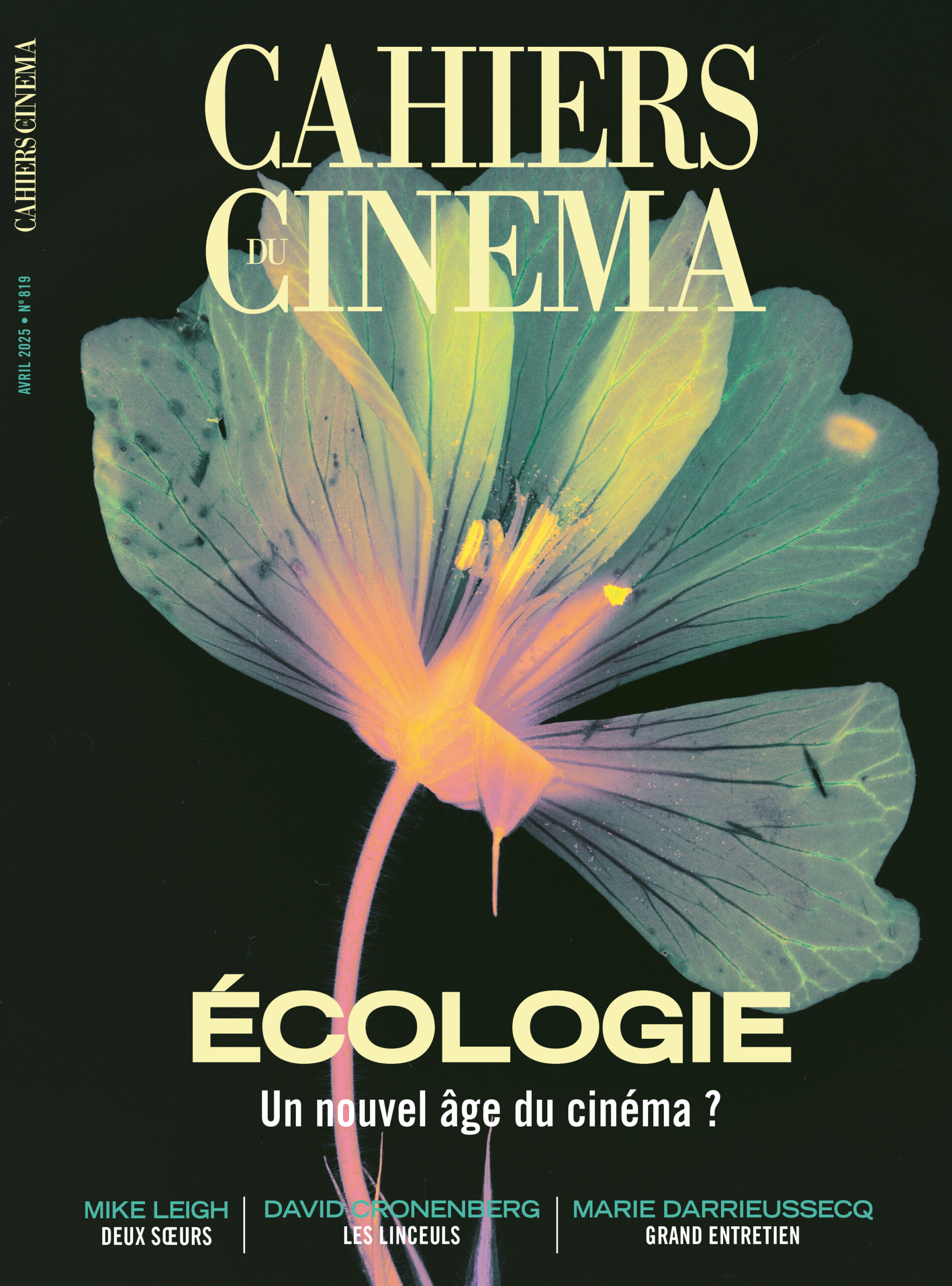
L’urgence d’être patient
Editos
Publié le 2 avril 2025 par
Parce qu’il a permis d’enregistrer la vie des humains dans leur environnement, qu’il a été instrument d’exploration et de science autant que de rêve, parce qu’il a pu imaginer toutes formes de catastrophes, de fins du monde, de dominations de l’homme par d’autres espèces, ou réinventer les proportions naturelles (un gorille grand comme un building, un homme réduit jusqu’à l’infiniment petit…), le cinéma a d’une certaine manière toujours pensé l’écologie. Et depuis les années 1950, il a accompagné par des fables toutes nos peurs en la matière : des radiations atomiques à la disparition de l’humanité, en passant par une multitude de déluges. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup de cinéastes aient fait preuve d’une conscience écologique lorsque celle-ci est devenue une question politique fondamentale. C’était dans le prolongement évident de leur manière de penser le paysage, la nature, notre place sur terre que Robert Bresson, Jean Rouch, Éric Rohmer, Luc Moullet ou Jean-Marie Straub et Danièle Huillet ont très tôt pris position sur ces questions. On se rend compte aujourd’hui combien ils étaient précurseurs, alors que beaucoup les prenaient pour des naïfs ou des ronchons excessifs.
On se souvient, par exemple, de Straub et Huillet dénonçant à propos de l’incendie final d’Apocalypse Now l’indignité d’un cinéaste capable de sacrifier une forêt pour une scène. Parmi les prises de conscience de la violence exercée sur la nature par des tournages, les plus évidentes furent celles où il y avait une contradiction flagrante entre ce que célébraient les films et leurs conditions de production. Par exemple, Louisiana Story de Robert Flaherty (dont, déjà, Nanook l’esquimau était financé par l’entreprise de fourrure Revillon Frères), qui se présente comme un film d’exploration des bayous à travers le regard d’un enfant, mais qui est au fond une publicité pour la société pétrolière Standard Oil, productrice du film. De même, le mythe du commandant Cousteau a été quelque peu écorné par ce que nous avons appris depuis du tournage de certaines scènes du Monde du silence, où furent massacrés des requins, lacérés des cachalots, détruits des récifs de corail, entre autres. En parler des décennies plus tard, c’est se réjouir que ce qui paraissait acceptable à une époque ne l’est plus du tout aujourd’hui. Car les cinéastes qui aiment véritablement filmer la nature et la vie sous toutes ses formes ne sauraient concevoir qu’un tournage nuise à ce qu’ils contemplent. Cela ne relève pas d’une vision candide mais au contraire d’une conscience aiguë de la violence et de l’offense en jeu. En ce sens, comme le suggère un intervenant dans le reportage qui ouvre notre dossier, la révolution écologique qui gagne les tournages de films n’est pas sans rapport avec le mouvement MeToo.
S’il fallait citer un cinéaste exemplaire dans sa façon de lier écologie, économie et esthétique, ce serait probablement Éric Rohmer. On repense bien sûr au monologue de l’instituteur interprété par Fabrice Luchini dans L’Arbre, le Maire et la Médiathèque face à l’arbre très ancien que l’on va couper pour construire une médiathèque dans un champ, dénonçant une certaine conception moderne de l’urbanisme, un faux accord avec la nature, plus hypocrite que le bétonnage. On se souvient aussi du carton au début des Amours d’Astrée et Céladon, expliquant pourquoi il lui avait été impossible de tourner sur les lieux mêmes du roman d’Honoré d’Urfé tant le paysage en question avait changé depuis le XVIIe siècle : « La plaine du Forez étant maintenant défigurée par l’urbanisation, l’élargissement des routes, le rétrécissement des rivières, la plantation de résineux. » Cette conscience du paysage est en parfait accord avec le choix de petites équipes, c’est-à-dire du désir que le tournage se coule dans le monde plutôt qu’il ne s’y impose : être là sans déranger, selon la leçon de Roberto Rossellini. Avec la conscience écologique devra naître une nouvelle économie du cinéma. Voyons-y aussi la possibilité de nouvelles manières de fabriquer et de penser les films : une modestie de moyens libératrice, où le temps n’est pas que de l’argent. Où, comme disait Straub, le vrai génie est la patience.
Marcos Uzal
Anciens Numéros