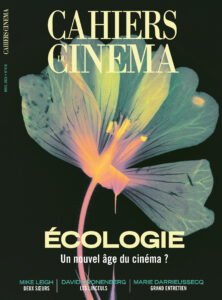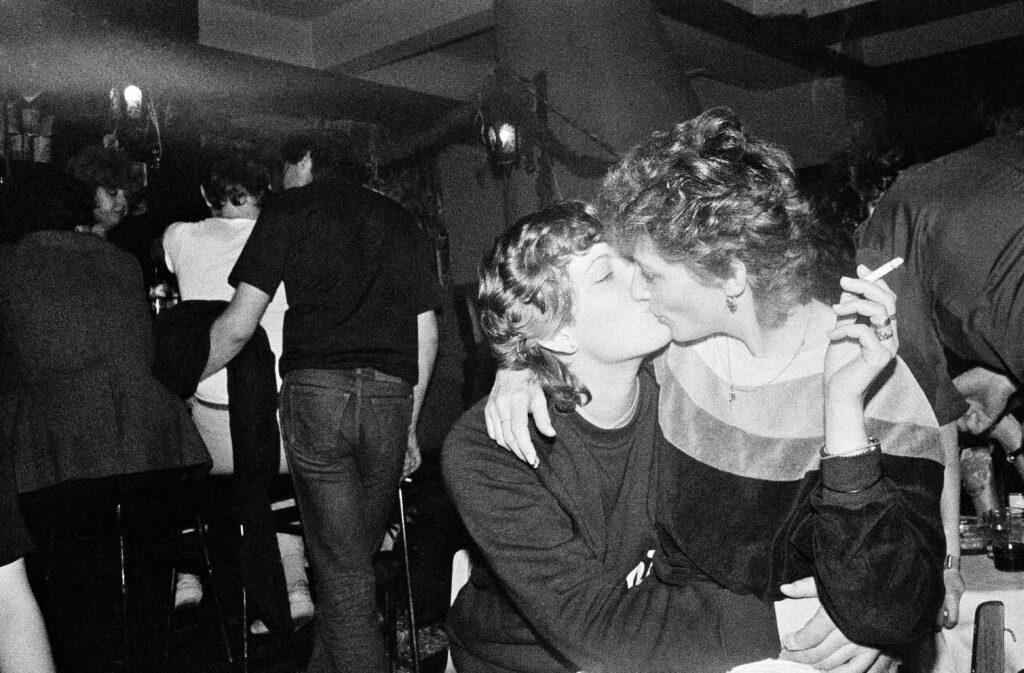Au Micro Salon, du lien et de l’IA
Actualités
Publié le 18 mars 2025 par
IMAGE. Installé au Parc floral de Paris, le Micro Salon de l’Association française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique (AFC) a réuni pour la 25e année chefs opérateurs, fabricants et loueurs de matériel. Quelques jours avant le sommet de l’IA à Paris et son contre-sommet simultané, une table ronde a été organisée pour interroger les répercussions des avancées technologiques dans la création audiovisuelle.
C’est à la fois un sujet de préoccupation et un problème encore inexistant. Parmi la vingtaine de groupes de travail de l’AFC, il en est un exclusivement consacré à l’intelligence artificielle ; mais, pour Yves Cape, chef opérateur de Guillaume Nicloux, Cédric Kahn, Michel Franco ou Bruno Dumont et trésorier de l’association, « l’IA n’a pas encore généré d’outils de création susceptibles d’être utilisés sur les plateaux de tournage. Elle peut servir avec finesse à l’étalonnage, afin d’éviter des tâches fastidieuses, et éventuellement au moment de la préparation du film, pour se donner quelques idées et communiquer avec un réalisateur, mais c’est tout. Je ne suis pas très inquiet: on aura toujours besoin de travailler de concert avec un réalisateur, un chef décorateur et un chef costumier pour inventer un univers et émouvoir avec des images ».
En ce qui concerne l’IA générative, si à large échelle elle ne fait pas le poids face à l’originalité des visions d’artistes et à la subtilité des acteurs, se dessine néanmoins aujourd’hui, pour ceux qui choisissent de travailler avec elle, une manière singulière de créer, dotée de méthodes et d’enjeux propres. Ruser à coup de paraphrases dans les instructions textuelles (les « prompts ») données à la machine pour contourner la rigidité des restrictions, variables en fonction des moteurs de fabrication d’images, visant à limiter par exemple le gore ou la pornographie ; constituer sa propre base de données à partir de laquelle l’ordinateur génère des images, afin d’éviter les multiples biais imposés par les datasets préconstitués; inventer ses modèles ou programmes, c’est-à-dire déterminer la manière dont l’IA répond aux demandes; choisir et monter, si l’on reste dans le domaine de l’image animée, les plans ainsi obtenus : comme dans n’importe quel autre processus de création, alors qu’on pourrait croire que tout devient à la fois possible et formaté, l’artiste se confronte avec l’IA à un ensemble de contraintes autant qu’il jouit d’une certaine marge de manœuvre.
Au-delà des innovations – l’IA peut désormais, par exemple, générer des images à partir de photographies ou de plans existants –, les interrogations les plus brûlantes sont d’ordre juridique. Lucie Walker, juriste de la postproduction, explique : « Il y a encore quelques mois, le bureau du copyright américain considérait qu’une œuvre, pour être protégée par le droit d’auteur, devait être intégralement créée par l’artiste lui-même. Les choses évoluent en ce moment : il y une dizaine de jours, un rapport de ce même bureau a établi qu’un prompt isolé relevait du domaine des idées, non protégeable, mais qu’une combinaison de prompts pouvait donner lieu à une œuvre originale si l’on parvenait à démontrer la part de créativité humaine nécessaire pour l’obtenir. Cette position sera progressivement adoptée ailleurs, notamment en France. » En plus de la paternité des œuvres, pose également question, de façon plus diffuse, la nature souvent obscure des données constitutives des datasets : rien ne vient garantir qu’elles sont libres de droits, au point de limiter l’usage de l’IA par les grands studios d’effets spéciaux et les plateformes, qui craignent de perdre la propriété de l’œuvre. Si l’on comprend que les cartes sont rebattues sans cesse, les freins à l’usage de l’IA générative sont ainsi autant juridiques que techniques et culturels – le réel, qu’elle nappe d’une inquiétante artificialité, lui résiste, et «on aura toujours besoin d’admirer des acteurs en chair et en os, de se relier à l’humain grâce au cinéma», comme le formule Vincent Mathias, directeur de la photographie. À terme, on peut penser que l’IA générative menace moins le cinéma et les chefs de poste que les petites mains dont les tâches sont progressivement automatisées, ainsi que le milieu plus standardisé de la publicité.
Mathilde Grasset
Anciens Numéros