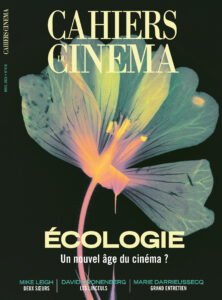Guillaume Brac, terrains d’entente
ActualitésEntretiensÉvénement
Publié le 24 avril 2025 par
RENCONTRE. Guillaume Brac est l’un des cinéastes les plus proches de ce qui pourrait être une école française de la nature. Ses deux films en salles ce mois-ci (lire page 67) laissent s’énoncer clairement une conscience écologique.
Ouverts aux averses, tournés la plupart du temps en extérieur et dans un lieu unique, les films de Guillaume Brac s’articulent autour de milieux plutôt que de paysages, entièrement dédiés aux relations que les humains entretiennent entre eux et avec une certaine portion d’espace. « Chacun de mes films est très ancré dans un territoire, confirme-t-il. Mon rapport à l’écologie se joue à la fois dans la légèreté de mon équipe et des moyens techniques que j’emploie, et dans cette échelle locale ; je ressens le besoin de filmer les habitants, y compris dans mes fictions, car un lieu sans humain n’a pas beaucoup de sens à mes yeux. » Ce rapport d’intimité à l’espace implique le réalisateur lui-même : « J’ai besoin d’avoir vécu des choses dans un lieu pour avoir envie de le filmer, et même pour me sentir en droit de le faire. On pourrait parler d’écologie du regard : cela consiste à prendre le temps de regarder ce qu’il y a autour, et à y trouver de la beauté ; elle peut être ingrate, âpre, mais il y en a presque toujours. Avant le tournage de L’Île au trésor, j’avais passé des journées entières, plusieurs mois durant, à simplement regarder la base de loisirs de Cergy-Pontoise, à me laisser traverser par tout ce qui s’y passait, jusqu’aux lumières et aux sons, comme si je filmais déjà. »
Si les émois des personnages sont catalysés par les lieux où ils séjournent, c’est parce qu’un état général de vacance le permet : « En vacances, on sort d’un rapport d’utilité et d’efficacité au temps et au lieu, pour lui préférer un rapport plus contemplatif et plus poreux à ce qui nous entoure ; les journées peuvent durer, les séquences aussi. » Les titres des films renvoient pourtant à l’imaginaire enfantin de la conquête aventurière, comme le documentaire Le Repos des braves qui, dans un versant plus sombre, suit des cyclistes à la retraite repoussant leurs limites dans une confrontation douloureuse aux reliefs alpins. « Mon rapport à l’espace, et même au fond au cinéma, a longtemps été déterminé par ma pratique du cyclisme, confie Brac. Quand on est sur un vélo, outre découvrir des territoires et s’offrir des moments de contemplation, on conquiert l’espace, ce qui coûte de l’énergie. J’ai eu le sentiment d’avoir grandi dans une bulle sociale assez privilégiée, et j’ai toujours eu le désir, à travers le cinéma, de m’approprier d’autres lieux, qui ont fini par rebattre les cartes de mon identité. S’il y a quelque chose à conquérir, ce n’est évidemment pas la nature, mais la possibilité de vivre quelque chose ensemble. » Dans Ce n’est qu’un au revoir, tourné à Die, dans la Drôme, une pensée politique est, pour la première fois chez Brac, explicitement formulée par les adolescents, qui contrairement aux personnages de ses autres films ne viennent pas de la ville : « Ils ont un accès et un rapport à la nature autres que les adolescentes d’Un pincement au coeur, qui ne cessent de répéter qu’elles n’ont nulle part où aller excepté le centre commercial. J’avais envie de montrer ces deux jeunesses, et d’adopter un autre regard que celui des personnages d’À l’abordage, qui étaient, comme moi à l’époque, des urbains. Je vis désormais dans la Drôme, et souhaitais épouser le point de vue de ces jeunes gens qui ont été façonnés par ce territoire. Le sujet principal est pour moi le rapport entre les générations : Jeanne fait part de son angoisse écologique mais celle-ci s’articule à la relation difficile qu’elle a avec ses parents, et plus généralement avec leur génération qui laisse la suivante se débrouiller dans ce monde abîmé. Je venais moi-même d’avoir deux enfants : sans l’avoir prémédité, sa parole rejoignait pleinement mes préoccupations. »
Mathilde Grasset
Propos recueillis en visioconférence, le 3 mars.
Anciens Numéros