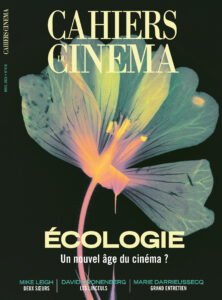Reprendre terre
PROGRAMMATION. Du 23 avril au 13 juillet, le Forum des images accueille le cycle de la Cinémathèque du doc/BPI, « Outsiders : Rebelles, excentriques, visionnaires », où le documentaire embrasse des existences hors norme.
Filmer des vies aux marges de la société, à sa périphérie ignorée ou méprisée, revient souvent à parier sur sa propre curiosité, à la mettre en jeu, au risque du voyeurisme. On n’en trouvera pas l’ombre dans cette programmation, préparée par Olivia Cooper-Hadjian (membre du comité de rédaction des Cahiers, ndlr) et placée sous l’égide des portraits d’artistes de Marie Losier (The Ontological Cowboy, 2005 ; Barking in the Dark, 2025), éperdument épris de leurs modèles, moulés sur leur extravagance et leur folie créatrice. Plus qu’un thème ou un territoire à défricher, la marginalité devient ici une énergie libératrice, capable d’entraîner dans son sillage le regard approbateur des cinéastes.
L’ethnographie de la marge n’est donc pas au menu, même dans The Moon and the Sledgehammer de Philip Trevelyan (1971), où la famille Page, vivant sans électricité au milieu des bois aux abords de Londres, porte quasiment en bandoulière son étrangeté anachronique. Si l’isolement du groupe évoque Grey Gardens des frères Maysles et son duo malsain mère-fille, le film a quelque chose de plus innocent. Ni hippies ni décadents, les Page luttent avec les moyens du bord pour le maintien d’un mode de vie rural : à les voir rafistoler des machines à vapeur, on dirait que c’est la marche même de l’histoire qu’ils essaient de freiner, avec un entêtement enivrant. Les amateurs du cinéaste Ben Rivers y retrouveront une influence indéniable : son court métrage Ah, Liberty (2008), programmé lui aussi, est emblématique du déboussolage temporel qu’il tire à son tour de simples jeux d’enfants, dans un monde où la nature et les déchets humains semblent faits du même bois.
Après les derniers chasseurs cueilleurs du Sussex, Nuestra voz de tierra, memoria y futuro des Colombiens Marta Rodríguez et Jorge Silva (1981) montre une communauté expulsée de ses terres et bien décidée à les reprendre. Du cinéma indigène et décolonial avant l’heure, qui inclut dans sa fabrication les voix et la cosmogonie d’un peuple pour attaquer l’histoire officielle sur un terrain aussi politique qu’esthétique. De quoi déranger une nouvelle fois le partage entre l’ancestral et le moderne : aux séquences d’organisation syndicale se heurtent des visions assimilant les propriétaires blancs à un diable à cheval (l’usurpation culturelle s’insinue donc jusque dans les cauchemars), rendues d’autant plus inquiétantes par le décompte des morts dans la réalité.
Programmés ensemble, Sandrine à Paris de Solveig Anspach (1992) et Blue Boy de Manuel Abramovich (2019) redescendent à l’échelle intime des visages scrutés pour y déceler l’étincelle mutine, le repli souverain : qu’il s’agisse d’une ex-pickpocket invitée à confier ses « bêtises » et racontée elle-même, en parallèle, par des témoins compréhensifs, ou de jeunes escorts roumains écoutant leur propre récit sous la lumière rose bonbon d’un bar berlinois, le portrait devient l’art de filmer la rébellion tranquille d’un sujet qui se sait pris dans les phares du jugement social.
Il faut enfin voir L’Exil et le Royaume, d’Andreï Schtakleff et Jonathan Le Fourn (2008), l’une des plus belles redécouvertes du cycle. Cela se passe à Calais, à une époque où il n’était pas encore question de « jungle », mais où le parcours des réfugiés vers l’Angleterre comptait déjà sa longue histoire de morts, de traques, de centres d’hébergement rasés. On pourrait s’étonner qu’au lieu de se tourner vers les migrants eux-mêmes, le film les laisse longtemps dans l’ombre, au bénéfice de portraits de citoyens en mission, résistants d’un nouveau siècle ; c’est pourtant ce parti pris qui en fait toute la force, puisque l’existence même de l’aide et du soin était (et demeure) elle-même invisible, jamais montrée : il est supposé, ici, que les nuits des uns et des autres ne s’opposent pas.
Élie Raufaste
Anciens Numéros