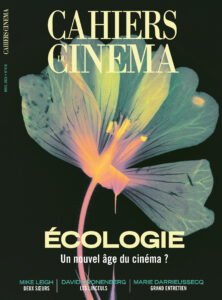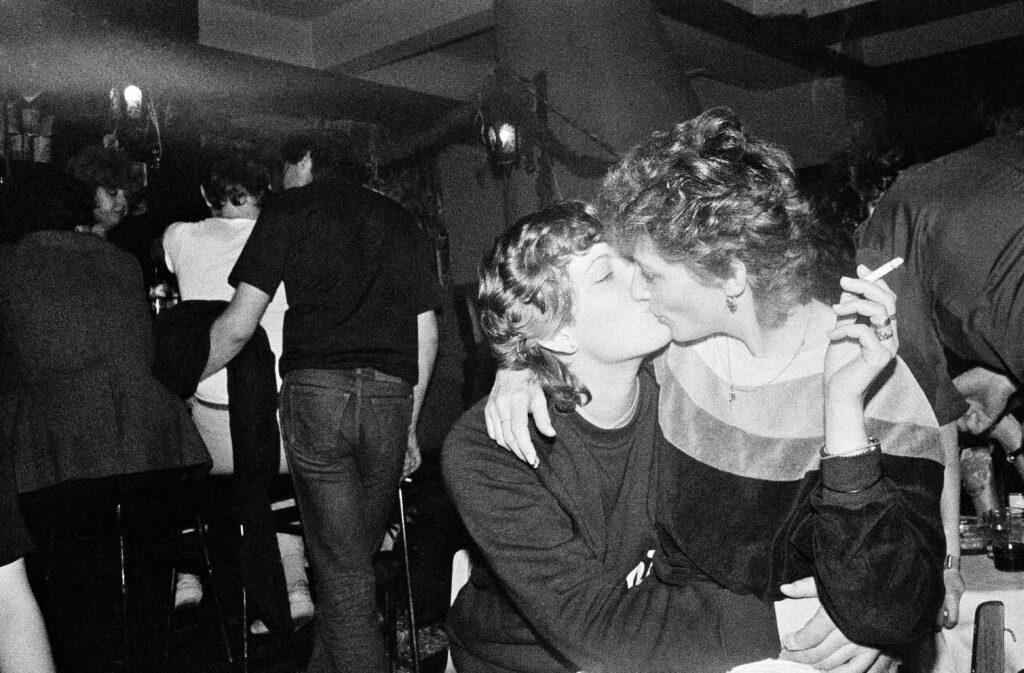L’esprit de la forêt
ActualitésCritique
Publié le 12 février 2025 par
« La forêt est vivante. Elle ne peut mourir que si les Blancs s’obstinent à la détruire», écrivait Davi Kopenawa, chaman yanomami, dans un ouvrage paru voilà quinze ans. Co-signé avec l’anthropologue Bruce Albert, La Chute du ciel (Plon, 2010) débute par une prophétie : si le « peuple de la marchandise », ainsi que Kopenawa appelle les Occidentaux, continue à polluer les rivières, dessécher les sols et répandre les maladies, alors les chamans périront et ne pourront plus appeler les esprits de la forêt, et quand le dernier chaman sera mort, le ciel s’effondrera. Moins adaptation qu’excroissance du récit de Kopenawa et Albert, le film d’Erik Rocha et Gabriela Carneiro da Cunha vient s’inscrire au cœur de cette forêt vivante, dont aucune carte ni aucun récit ne peuvent restituer la profusion sensorielle. Seule la caméra nous permet d’en faire l’expérience, à condition d’échapper à la « probité » de l’écriture ethnographique aussi bien qu’aux fictions d’un certain régime de l’art.
Le long plan-séquence d’ouverture a valeur d’axiome méthodologique : c’est un plan d’ensemble sur une piste dégagée au milieu de la forêt, ceint, au fond de l’image, par l’épaisseur touffue des arbres. Depuis cette profondeur, une communauté marche vers nous, hommes et femmes, enfants et vieillards, certains portant des pagnes colorés, d’autres des shorts et tee-shirts élimés, arcs et fusils, flèches serties de plumes et paniers tissés de feuilles de bananiers, c’est tout un peuple qui s’avance. L’écho de leur chant enfle à mesure que leurs pas se rapprochent, et finit par submerger tout l’espace du cadre tandis qu’ils dépassent la caméra et continuent leur chemin. Voilà le parti pris des cinéastes brésiliens qui s’effacent complètement derrière la vision indigène, laissant la charge du récit à Kopenawa lui-même, sans pour autant oblitérer leur perspective, car c’est bien à eux, napë (les Blancs), que tous ici s’adressent. Il faudra les fragments d’un discours autobiographique, disséminés dans les propos en voix off de Kopenawa, pour comprendre plus tard que cette piste effacée est un vestige de l’autoroute que le gouvernement brésilien entreprit de tracer à travers la forêt dans les années 1970. Inachevé, le chantier de cette voie transamazonienne aura constitué l’une des grandes batailles des Yanomami et permis la reconnaissance de leur territoire par l’État en 1992.
Vers quel destin marchent-ils aujourd’hui ? Ils ont l’air de partir en guerre, ou bien de fuir les mineurs et orpailleurs qui n’ont cessé d’envahir leurs terres depuis la nouvelle ruée vers l’or du début du siècle. Légalisée par Bolsonaro après son arrivée au pouvoir, celle-ci a répandu les épidémies et les crimes au sein des communautés autochtones. Mais de ces envahisseurs et de leurs atrocités, le film ne nous accordera aucune vision, préférant maintenir hors champ leur présence menaçante. C’est par la technologie que se manifeste la proximité de ces spectres du colonialisme, à travers les messages radio qui signalent leur passage sur le territoire indigène et préviennent les communautés de leur arrivée, ou bien le bruit des petits avions qu’utilisent les chercheurs d’or pour survoler la forêt. Ce qui occupe au contraire tout l’espace du cadre, c’est le rituel qui matérialise la cosmologie yanomami, une cérémonie funéraire en l’honneur d’un chaman – celui qui a initié Kopenawa – à laquelle se rend le groupe de marcheurs. En filmant ce rituel, Rocha et Carneiro da Cunha cherchent moins à constituer une archive, comme autrefois l’ethnologie d’urgence qui tentait de sauvegarder la trace de cultures menacées par la colonisation et l’industrialisation occidentales, qu’à adopter la perspective yanomami sur la catastrophe en cours. Par l’effet conjugué du cadre et du montage, ils condensent dans un vertige de sensations les souvenirs et les songes, le témoignage de ceux qui ont vu leurs proches décimés par les épidémies et les manifestations des Xapiri, ces esprits de la forêt qui maintiennent encore le monde à l’endroit. Ni enquête ethnographique, ni fable édénique, La Chute du ciel redéfinit les termes d’une relation où l’on s’observe de part et d’autre de la caméra. Il y a bien des risques dans une telle entreprise, à commencer par celui de rejouer l’exotisme d’une fascination qu’exercent la transe psychédélique et les visions qu’elle produit. Mais contrairement à Antonin Artaud et à son initiation au peyotl au pays des Tarahumaras, cette immersion dans le monde des esprits n’ouvre à aucun délire mystique, parce qu’elle est constamment rapportée à une histoire de la violence coloniale et à sa continuation dans le présent.
La Chute du ciel accomplit ainsi le projet deleuzien d’un cinéma qui, pour échapper au double colonialisme de l’imposition des histoires des conquérants et de l’assimilation des mythes et récits autochtones, filme des êtres bien réels «en les mettant eux-mêmes en état de “fictionner”, de “légender”, de “fabuler”.» (L’Image-Temps). « Fabuler» signifie alors entrer dans une parole qui fait coïncider le mythe et l’histoire, le rêve et le présent, le récit et la communauté. C’est une gageure que d’y parvenir pour ce film qui prend le risque de conjuguer la voix de Kopenawa avec celles des habitants de la forêt, humains ou non, présences réelles ou esprits invisibles, comme pour l’enrichir de cette polyphonie. Il n’y a qu’une séquence où la tentative tourne à l’échec, quand les deux cinéastes se mettent en tête d’illustrer la prophétie de la chute du ciel par un montage calamiteux emprunté à La Nature d’Artavazd Pelechian. La basse définition des images de catastrophes naturelles archivées sur YouTube vient alors coloniser le récit yanomami, comme si cette représentation très convenue de l’apocalypse pouvait rehausser le mythe. C’est oublier combien l’absence d’images est parfois plus puissante que leur monstration et qu’il n’est pas besoin de lancer des clins d’œil à de vieux cinéastes pour faire de grands films.
Alice Leroy
Anciens Numéros