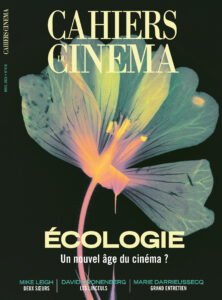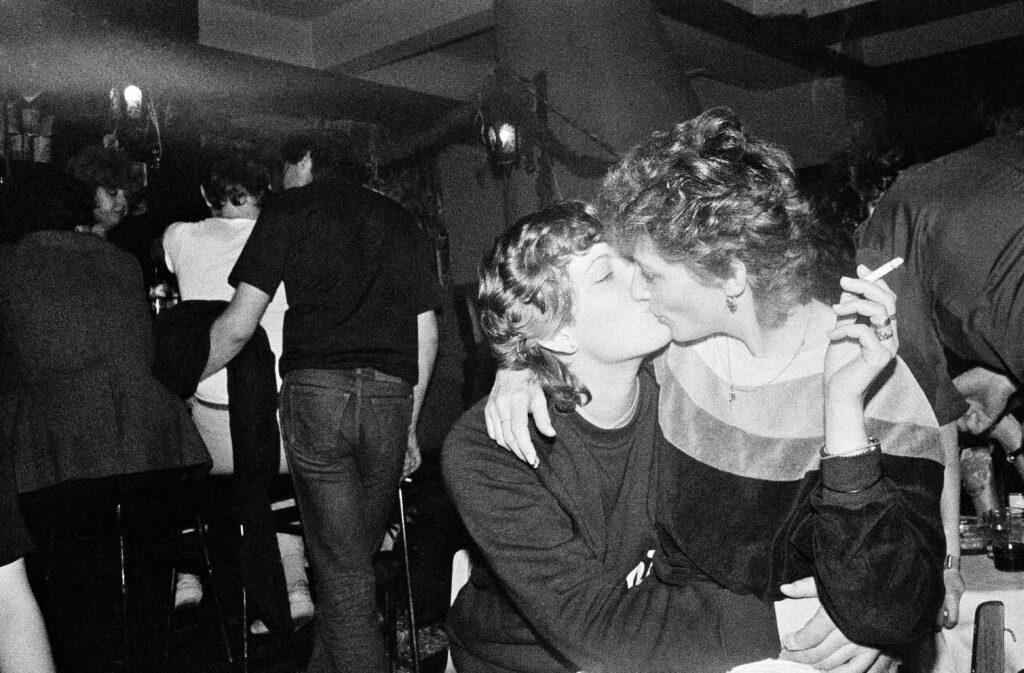Mains dans la main
ActualitésCritique
Publié le 28 janvier 2025 par
Accompagnant l’arrivée du petit Mamadou dans le groupe scolaire Anton-Makarenko d’Ivry-sur-Seine, le cadre s’attarde sur un geste : la main du directeur qui tient celle du nouveau venu. Scrutant une cour de maternelle, Claire Simon révélait dans Récréations (1993) que les enfants n’étaient pas des anges mais reproduisaient normes et violences dans leurs moments de liberté. L’ouverture d’Apprendre et ce geste de prise en charge indiquent que la cinéaste y dévoilera ce que cet opus précédent, où la caméra s’arrêtait au seuil des bâtiments, laissait hors champ. Si la cour apparaît de nouveau comme un petit théâtre sous l’empire de la pulsion et de la cruauté, comme lorsqu’un élève pâtit d’être exclu des jeux par une camarade intransigeante, la médiation enseignante, cette fois, s’en mêle : passage par le bureau d’un directeur qui explique que la parole vaut mieux que les coups, cours organisant le drame d’un jeu de dames pour faire intégrer aux compétiteurs les règles du fair-play. Jeux et mots pour ne pas en venir vilainement aux mains et guider sur le chemin de la vie en société.
Mettant de côté le fonctionnement de l’institution proprement dit, sautant d’une classe à l’autre (de la maternelle au primaire) plutôt que d’élire un centre, Claire Simon filme la relation d’apprentissage à travers une série de situations où se mêlent français, calcul, sport, atelier de physique, chant, etc. Manière de battre en brèche toute hiérarchie des savoirs et de montrer que l’école n’a qu’une seule vraie matière première : ses élèves. Matière des cours autant que matière documentaire, corps-sujets dont la caméra saisit la concentration et la réflexion autant que la distraction et la peine. Une question grammaticale peut ainsi occasionner une torture mentale, directement réfléchie, dans les mains d’un élève, par la torsion d’une règle en plastique. Posé sur un groupe scolaire d’une ville communiste à la politique éducative apparemment vertueuse, le regard sur une institution souvent suspectée de parenté avec la prison semblerait relativement édénique si le récit n’avançait en additionnant les dimensions et les nuances.
Une séquence à mi-parcours, mettant en scène un élève en situation de handicap, vaut comme une sorte de tournant, l’apprentissage s’adaptant et s’enrayant tout à la fois, peinant à trouver le temps et l’espace pour des corps qui ne tiennent pas en place. Contre une tendance centripète reflétée par un gros plan de la main du directeur fermant à clef la grille, Claire Simon veille surtout à rendre sensible une porosité et une tension entre l’îlot scolaire et le monde, le désir de transmettre des connaissances générales ayant pour envers la situation d’élèves de banlieue. Sortie en bateau-mouche, cours de géographie, débat sur les coutumes religieuses, rencontre musicale : l’apprentissage devient progressivement affaire de déplacements et d’ouvertures, mais au sein desquels l’inscription sociale des corps et des esprits fait immanquablement retour. Quand une élève de l’École alsacienne en visite gratifie l’assistance d’un morceau de Chopin, un élève ivryen peu recueilli semble dans un bref plan à deux doigts de perturber cette performance avec ses baguettes de tambour: touche de montage, dissonance introduite dans la rencontre des classes.
Apprendre enregistre ainsi un idéal et sa difficulté à passer dans des corps physiques et sociaux. D’un premier cours où la maîtresse prend le temps de dire bonjour à chaque élève à une fin sur une reprise en chœur du « Diamonds » de Rihanna marquant le passage vers le collège, le film redouble aussi dans ses images le défi de l’école : non pas uniformiser et mener à la baguette (versant High School de Wiseman) mais verser le singulier dans le collectif, accueillir dans un cadre unique et mouvant les accords et les désaccords. Cadre forcément fragile et temporaire. Quand les grilles s’ouvrent, il faut rendre la main.
Romain Lefebvre
Anciens Numéros