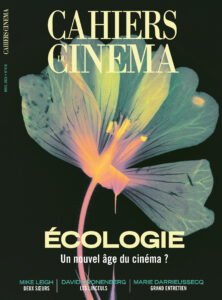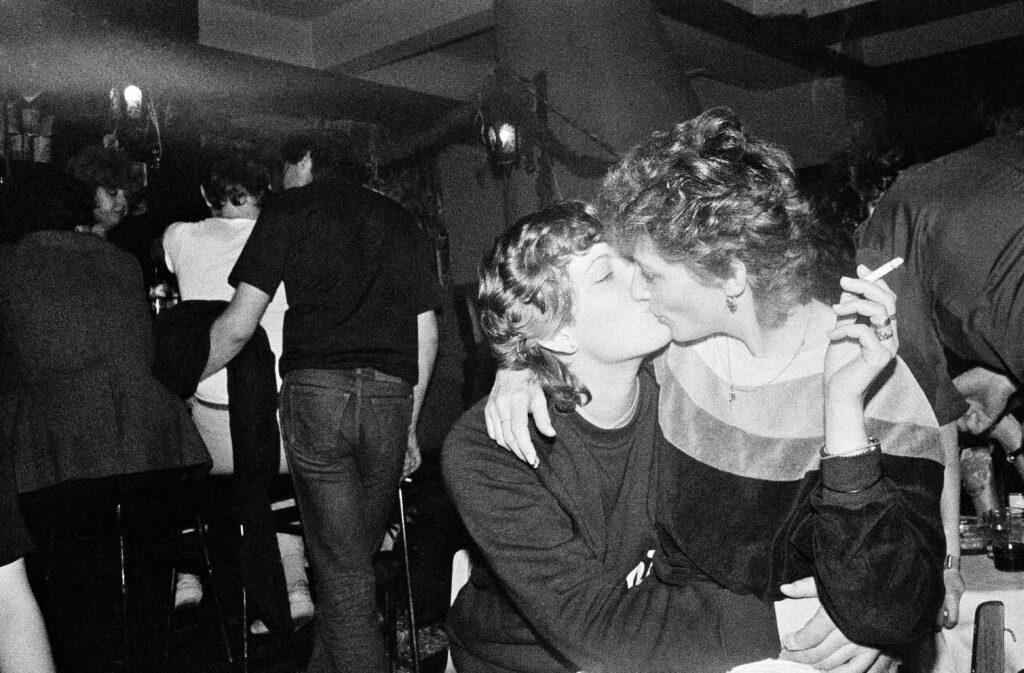Pour faire le portrait d’un oiseau
Au nombre des cinéastes qui travaillent inlassablement les mêmes motifs, il y a Andrea Arnold, six longs et trois courts aux titres laconiques, dont plusieurs renvoient à la vie animale : Dog, Wasp, Fish Tank, et même Cow, seul documentaire d’une œuvre qui s’épanouit d’habitude dans la fiction, mais où le portrait d’une vache laitière rejoue les mêmes obsessions – la condition d’opprimée (spécifiquement féminine), l’exploitation du labeur, la maternité contrariée, l’empathie et la sensualité d’une mise en scène qui cherche à s’accorder à la présence des corps plutôt qu’à dérouler les étapes d’un récit. Bird revient à la fiction, et s’aventure même au bord du fantastique, mais c’est une nouvelle interprétation de la même partition : Bailey (Nikiya Adams, pour la première fois à l’écran), 12 ans, habite un squat avec son père, Bug (Barry Keoghan), qui n’a pas encore 30 ans, son demi-frère Hunter (Jason Buda) qui en a 14, et une nouvelle belle-mère (Frankie Box) qu’elle voit d’un mauvais œil débarquer avec sa petite fille.
La vie s’égrène au gré des errances à travers les rues et les champs, des histoires du quartier et des lubies paternelles – pour financer sa noce avec sa dernière conquête, son père s’est entiché d’un crapaud dont la bave est censée produire un puissant et lucratif hallucinogène. La rencontre de Bailey avec Bird (Franz Rogowski), un garçon étrange surgi de nulle part dans son kilt qui lui donne des allures de clochard céleste, ouvre un nouvel horizon à l’adolescente qui se met en tête de l’aider à retrouver ses parents. Cette quête la mène à renouer avec sa propre mère et à affronter un beau-père abusif. Ainsi résumé, le scénario de Bird évoque le Kes de Ken Loach, qui regardait le jeune Billy échapper à la morosité d’une vie prise en étau entre l’école et la mine grâce à un petit faucon. Bailey partage d’ailleurs avec Billy le goût de la solitude et de la rêverie, sauf qu’Arnold refuse aussi bien le naturalisme que le mélodrame de Loach.
D’abord parce que Bird est un drôle d’oiseau, en dépit de son habitude de manger des graines et de se percher sur les toits d’immeubles. Tous les personnages glissent doucement vers l’allégorie : Bug (« l’insecte »), le père virevoltant sur sa trottinette électrique avec son crapaud sentimental; Hunter, le demi-frère « chasseur » de prédateurs en tous genres à la tête d’une bande de vigilantes adolescents; ou encore le beau-père ogresque dont la violence aura raison de l’innocent chien familial. Ensuite, parce que la fable épargne à ses personnages la cruauté d’un destin auquel les aurait peut-être condamnés un récit plus naturaliste. Arnold aime ses personnages sans avoir pour autant besoin de les ériger en working class heroes. Dans ce film à fleur de peau, la mise en scène éprouve moins la vérité des personnages que leur sensibilité, une certaine qualité de leur regard sur un monde qui ne leur fait pas beaucoup de place – Bailey emmenant sa petite fratrie pour une journée en bord de mer et s’émerveillant de trouver des poissons dans l’eau, ou Hunter rêvant de fuir les parents de sa copine enceinte en Écosse. Tout ici fait signe, depuis le serpent de la voisine qui mue au moment où l’adolescente a ses premières règles, jusqu’aux tags des cages d’ascenseur et des bus qui lui adressent des messages de réconfort (« Don’t you worry »), en passant par un morceau du groupe irlandais Fontaines D.C. (qui rappelle que « life ain’t always empty »). Et c’est parce que ce territoire, à la fois si familier et si propice à l’imaginaire, est peuplé de tels signes qu’il devient possible d’y raconter d’autres histoires.
Alice Leroy
Anciens Numéros