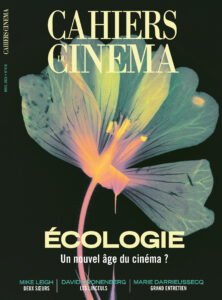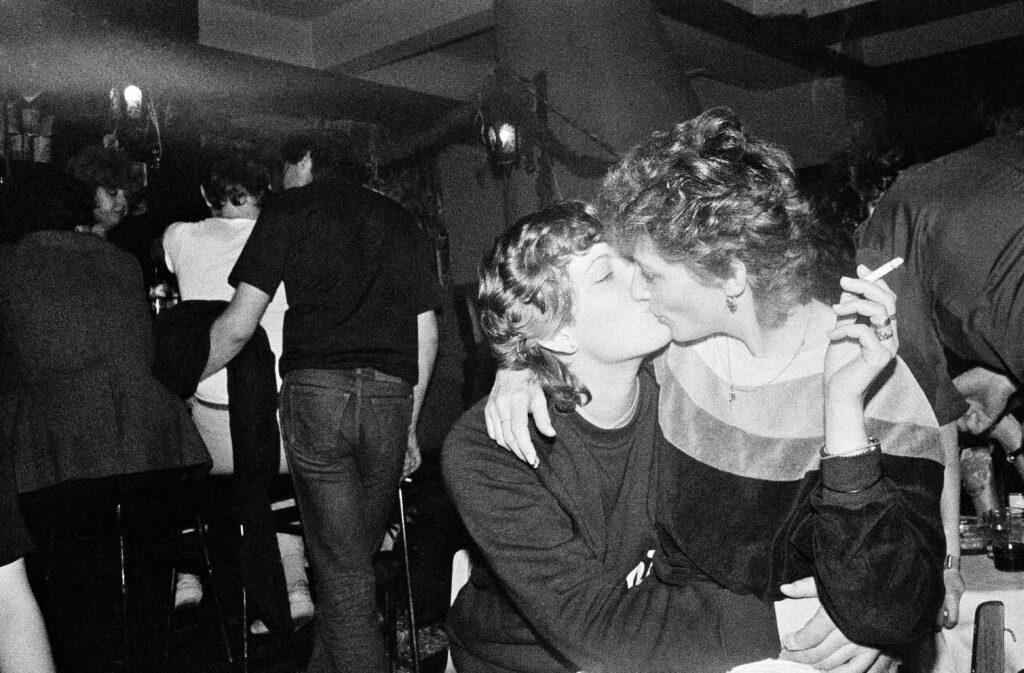Sculpture et mémoire. Quatre films de Marguerite Duras
Actualités
Publié le 25 mars 2025 par
Sculpture et mémoire. Quatre films de Marguerite Duras de Suzanne Liandrat-Guigues
Presses universitaires de Rennes, « Épures », 2024.
Une incise, en gravure, est un motif ciselé dans la matière. Dans les films de Marguerite Duras, c’est la voix off qui tenterait d’inciser la surface, de se déposer sur le film et sur les sculptures qui apparaissent à l’image. Comme une entreprise de raccorder ou d’unifier les choses, en un oxymor vertigineux.
L’essai de Suzanne Liandrat-Guigues est une suite à son Cinéma et sculpture. Un aspect de la modernité des années soixante, paru en 2002. L’autrice reprend là où elle en était restée avec L’Année dernière à Marienbad d’Alain Resnais, Méditerranée de Jean-Daniel Pollet, Le Mépris et Une femme mariée de Jean-Luc Godard, pour sauter une décennie et s’attarder sur les quatre films de Marguerite Duras où apparaît la sculpture. Ceux-ci poussent l’idée cinématographique de la modernité à son comble dans cette disjonction du sonore et du visuel si caractéristique. Pour Liandrat-Guigues et « comme l’ambitionne Duras, il est souhaitable de faire entendre ou d’amener à penser cette disparition [du lien de l’homme avec le monde] au cours d’une expérience intérieure que peut favoriser le recours à la sculpture par son mutisme, sa densité, son obscurité ou sa friabilité et son effritement ».
Le trauma de la guerre se loge dans le travail cinématographique de l’écrivaine de la période 1976-1982, que Liandrat-Guigues met en relation directe avec la découverte des fameuses pages qu’elle avait rédigées plus jeune, retrouvées tardivement, et donnant son livre le plus saisissant : La Douleur (1985), d’après les souvenirs de son mari Robert Antelme, déporté en 1944. « La diversité des formes statuaires recrée, de film en film, ce que Douleur veut dire pour Duras. Sortant du rôle de décor ou de motif ornemental, la sculpture relève d’une “brocante” d’objets qui “sont doués d’éternité, de tristesse si vous voulez”, dit-elle. » En une écriture aussi dense que claire – là où les textes de Duras en voix off sont souvent lacunaires et implexes –, telle une enquête (parfois dans le noir d’un film – plans noirs ou passages assombris de Césarée – ou dans l’invisibilisation d’une sculpture – Le Navire Night), Liandrat-Guigues décèle des points d’achoppement ou, justement, de discordances, a priori irréconciliables entre bande image et bande son (dans Césarée ou Le Dialogue de Rome). Les films, difficilement prompts à se laisser cerner, s’ouvrent à l’analyse : ainsi, quand elle décrit, plan par plan, une obscurité et une statue abandonnée dans Son nom de Venise dans Calcutta désert, quatre pages font émerger les idées les plus sombres de l’Histoire : la torture, le four crématoire et l’allusion à la déesse Léthé qui « offre la coupe de l’oubli ».
Car Duras nous met face à un « double effondrement, matériel et mémoriel » du monde. Le livre invite à une fouille qui donne forme, biographie de Duras à l’appui, à cette « matière commune animée d’un continuel remuement » : dans cet ensemble de films, la sculpture est « l’autrement dit », la destruction, l’histoire du génocide juif et le « choix des sculptures variant les styles, les époques, les usages et les fonctions, est à l’image de la déportation démultipliée conçue par Duras ». L’écrivaine-cinéaste affirmait en 1982 : « Ce qui m’intéresse, c’est de faire entendre un texte accompli au cinéma. » (Le Monde extérieur. Outside 2.)
Ce court livre a le grand mérite de mieux faire entendre ses films, et de « faire consoner les inconciliables historiques dans cette communauté des souffrances ».
Philippe Fauvel
Anciens Numéros