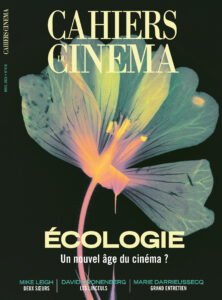Evgenia Alexandrova, lumière plastique
AU TRAVAIL. Lauréate 2024 du Prix de la jeune technicienne de la commission supérieure technique de l’image et du son (CST), Evgenia Alexandrova partage son parcours de cheffe opératrice aux longs métrages particulièrement éclectiques, des Femmes au balcon (en salles ce mois-ci) au très beau documentaire Machtat de Sonia Ben Slama, ou au prochain film de Kleber Mendonça Filho, prévu pour 2025.
Quel a été votre parcours avant d’arriver au long métrage ?
Je suis née et j’ai grandi à Saint-Pétersbourg. J’avais fait des études de commerce et suis venue à Paris pour faire mon master à l’ESSEC, puis travailler pour un grand groupe ; mais j’ai très vite compris que je ne voulais pas faire ça. J’avais encore 22 ans, je pouvais tenter autre chose. J’ai toujours eu une passion pour le cinéma, mais le métier semblait totalement inaccessible. En France, ça semblait tout à coup possible. J’ai réussi à rentrer à la Fémis après deux tentatives. Ensuite, j’ai fait un peu d’assistanat, mais j’ai privilégié la chefoperie sur des courts métrages.
Pourquoi choisir ?
Le tournage d’un court peut être bref, mais ça implique trois semaines de préparation, très vite on se retrouve à devoir refuser l’appel des équipes de longs métrages avec qui on travaille en assistanat. Aussi, vous êtes très vite classée sur l’un des deux parcours. Et ce n’est pas le même métier. À la limite, je trouve plus logique de devenir chef opérateur après avoir été électro qu’après l’assistanat.
Le premier film de Noémie Merlant, Mi iubita mon amour, marque aussi vos débuts sur long métrage. Comment vous avait-elle repérée ?
Pour son court métrage Shakira, elle avait travaillé avec Raphaël Vandenbussche, chef opérateur de la Fémis. Mais là elle allait filmer dans une famille de Roms qui ne voulaient pas d’hommes à la maison, et Raphaël lui a donné mon contact. Puis j’ai travaillé sur Sans cœur de Nara Normande et Tião. Le budget était réduit, on tournait avec des adolescents et des acteurs non professionnels, tout était filmé à l’épaule, ce côté très artisanal m’a beaucoup plu. Mon expérience dans les courts métrages, où l’on traverse beaucoup de galères, m’a énormément aidée. On a utilisé une Alexa mini, puis on a beaucoup travaillé le grain avec mon étalonneur habituel, Vincent Amor, ce qui donne au film une texture presque argentique. C’est quelqu’un qui n’a pas peur de bousculer mes images, de me montrer des choses que je n’avais pas vues.
On imagine souvent le contraire: le chef-op qui n’aime pas qu’on vienne manipuler son travail.
J’ai l’horreur de la maîtrise absolue. Ce n’est pas organique, ce complexe de dieu, et réduit la place réservée au hasard, à la possibilité du monde de s’exprimer à travers votre travail.
Est-il facile d’imposer son étalonneur à une production ?
En général, on est sollicité pour voir avec qui on veut travailler. Mais là, par exemple, je viens de finir le tournage du nouveau film de Kleber Mendonça Filho, et pour des questions de coproduction il a fallu faire l’étalonnage en Allemagne avec un technicien local. Ça peut donc arriver, mais pas en raison d’une volonté de contrer mes désirs. C’est le jeu.
Est-ce que vous aviez eu ce sentiment de laisser le monde s’exprimer davantage en travaillant sur un documentaire comme Machtat ?
C’est justement ça qui m’a plu. C’est très jouissif, cette cohabitation entre ce que l’on ressent et ce qui se déroule devant votre caméra. Sonia Ben Slama me transmettait ses envies chaque soir, quand on regardait les rushes. Mais le lendemain, elle me laissait faire. Je ne me suis servi que de focales fixes, sans zoom, ce qui m’a obligée à cadrer physiquement, sans me cacher dans un coin. Il fallait faire la réflexion du montage, découper en cadrant. Les femmes qu’on a filmées nous laissaient être tout près d’elles, parfois à quelques centimètres, tout enfaisant comme si on n’était pas là, c’était une chance extraordinaire. Je ne parle pas l’arabe, alors je filmais sans comprendre. Si je trouvais un regard, un geste qui racontait quelque chose, c’était ça ma matière. J’ai filmé Machtat comme un film plastique, un film de corps, pas un film de parole.
Vous cadrez toujours vos films ?
J’adore cadrer, je ne lâcherai jamais la caméra.
Que pensez-vous de la possibilité, de plus en plus en vogue, de recadrer en postproduction ?
Par qui ? C’est la vraie question. Aujourd’hui, beaucoup de chefs-op choisissent de très grands formats, 6K, 8K, à cause de cette peur, ou ce besoin de marge pour un recadrage ultérieur. C’est dommage. Mais je suis aussi la première parfois à recorriger mes cadres. Le montage peut nécessiter de partir d’un plan serré quand on a fait un plan moyen, et la narration l’emporte, c’est le principal.
Il est difficile de garder un pied dans le documentaire et un pied dans la fiction ?
Pas tant que ça. J’ai certes dû refuser une session de tournage du deuxième film de Sonia, près de Chicago, à Bloomington, un coin très redneck et trumpiste où se trouve un bar queer depuis trente ans. Il aurait fallu que je parte l’été, alors que j’avais déjà commencé le tournage des Femmes au balcon, et j’ai donc conseillé quelqu’un de confiance. La difficulté concerne strictement les plannings différents, pas tellement de se retrouver dans une case. Pour un chef opérateur, le fossé est moins grand entre fiction et documentaire qu’entre cinéma d’auteur et cinéma grand public, d’après mon expérience.
Souhaiteriez-vous avoir des expériences dans un cinéma plus commercial ?
Après Les Femmes au balcon, j’ai enchaîné avec une comédie grand public, Avec ou sans enfants d’Elsa Blayau (sortie en février 2025, ndlr). J’étais curieuse de l’exercice, concevoir des scènes avec beaucoup de personnages, traduire la comédie dans un langage visuel… Mais je trouve que le plus intéressant pour nous se trouve dans le mélange des genres, ce qui justement caractérise en ce moment le nouveau cinéma d’auteur français.
C’est l’une de singularités des Femmes au balcon… Quels étaient les enjeux à l’heure de filmer le trio principal ?
Noémie voulait que l’image soit « vraie ». J’ai choisi une optique assez douce, la P Vintage de Panavision, mais je n’ai pas du tout filtré en cherchant à lisser les peaux, enlever grains de beauté, cellulite, etc. Ce qui était important, c’était la progression visuelle: on commence dans un univers estival, coloré, pour petit à petit aller vers une forme de folie, avec beaucoup de focales qui déforment. L’image part un peu en cacahuète, mais avec les filles c’est totalement voulu.
Est-ce qu’un dialogue peut se former entre les acteurs et vous, en excluant le ou la cinéaste ?
J’ai l’impression que les comédiens veulent toujours se gagner l’amitié du chef-op. (Rires) Tout ce qui est physique peut être objet de partage : préférence de profil, aspects du corps qu’on ne veut pas montrer… Mais il y a quelque chose de plus. Il faut que je réponde à ce que l’acteur est en train de donner, une forme d’interaction. Il est important pour moi de sentir cette empathie-là. Ce qui est drôle, c’est que parfois cette relation n’existe plus une fois la scène finie, je n’ai pas besoin d’être pote avec la personne filmée, de boire des coups ensemble ni de connaître sa vie. Mais un rendez-vous a lieu, je ne peux pas faire abstraction de ça.
Entretien réalisé par Fernando Ganzo à Paris, le 19 novembre.
Anciens Numéros