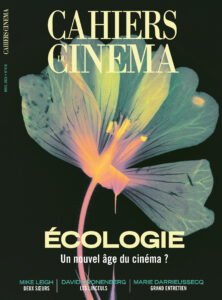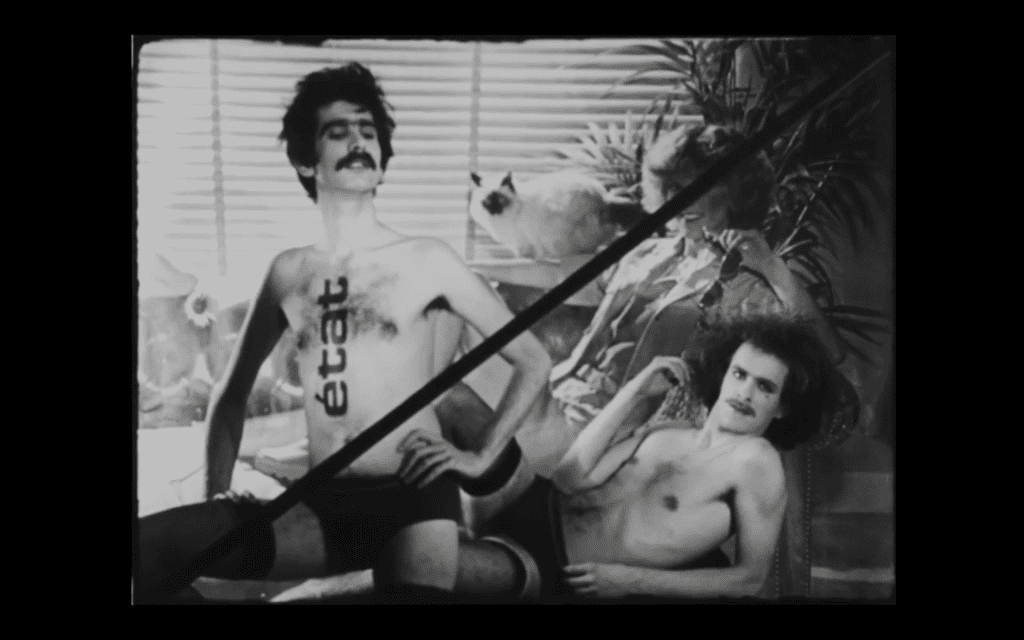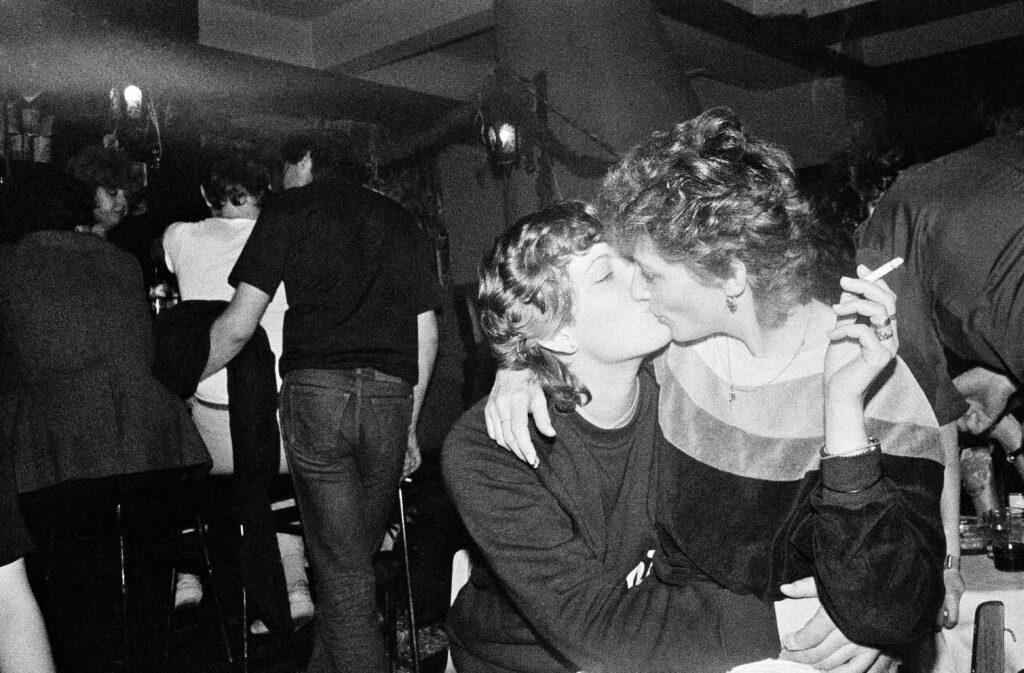Oran, en attendant les hirondelles
ALGÉRIE. Après six ans d’interruption, la 12e édition du Festival international du film arabe d’Oran avait des allures de nouvelle première fois. L’occasion de dresser un état des lieux d’un paysage cinématographique algérien sinistré.
Pour sa reprise, le Fiofa, financé par le ministère de la Culture ( le calicot de l’Onci, Office national de la culture et de l’information, ornait toutes les salles ), présidé par Abdelkader Djeriou et dont la direction artistique est assurée par Lynda Belkhiria, avait fait les choses en grand, avec une cérémonie d’ouverture et de clôture très couverte médiatiquement, tandis que le festival se déroulait plus discrètement dans les trois cinémas du centre-ville (le Maghreb, l’Es-Saada ou ex-Colisée et la Cinémathèque algérienne d’Oran), belles et anciennes salles, mais à la qualité de projection discutable. Dans un pays où les manifestations cinématographiques sont rares ( les deux historiques et indépendantes demeurent Annaba et les rencontres de Bejaïa, qui ont fêté leur 19e édition ), cette édition du festival d’Oran avait valeur de signal politique fort, témoignant du souci de l’actuel gouvernement d’officialiser son plan de relance en faveur du cinéma, après avoir été tenu de faire le contraire. Sentiment d’abandon plus que légitime partagé par les acteurs du cinéma algérien, que ce soit dans le pays ou pour ceux de la diaspora vivant en France, aux conséquences terribles pour le positionnement de cette cinématographie par rapport à ses confrères ( les jeunes cinémas marocain et tunisien, particulièrement remarqués ). Peu de temps avant le festival d’Oran, a été inaugurée à Alger une nouvelle école de cinéma, le Haut institut national de cinéma Mohammed Lakhdar-Hamina, destiné à former aux différents métiers du secteur, sur le modèle de la Fémis. En parallèle à cette politique à long terme, on envisage la construction de studios à Timimoun, en plein désert du Sahara, là où naguère le réalisateur Mohamed Chouikh avait créé son festival ( voir le hors-série des Cahiers, « Où va le cinéma algérien? », 2003 ).
En juin dernier, la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, a fait ces annonces ( ce qui a laissé peu de temps au festival d’Oran pour se remettre en place), la plus importante étant la réactivation prévue pour 2025 du FDATIC (Fonds de développement des arts, des techniques de l’industrie cinématographique), brutalement interrompu par le gouvernement le 31 décembre 2021, ce qui a suscité colère et indignation. Il s’agit d’un fonds historique, créé en 1968, doté par le gouvernement, dont 80 % du budget est affecté à la production et à la diffusion du cinéma algérien. Plusieurs versions circulent sur cet arrêt. Contrairement à ce qui a pu être dit, la suppression du FDATIC n’est liée à aucune censure envers le cinéma car c’est une injonction du ministère des Finances et de la Cour des comptes. On le sait, le cinéma algérien a eu du mal à passer d’un cinéma entièrement dépendant de l’État (réalisateurs et techniciens salariés, matériel technique et postproduction) à un régime semi-privé. Dans les années 2010, plusieurs projets ayant bénéficié du FDATIC n’ont pas vu le jour, des producteurs peu scrupuleux ayant reçu l’argent sans faire le film. D’où la raison de la mise en veille de ce fonds, en complément duquel avait été fondé en 2010, au temps du président Bouteflika, le CADC (Centre algérien de développement du cinéma), opérationnel en 2015 et coproducteur de tous les films financés par le ministère via le FDATIC. Depuis la disparition du FDATIC, il est redevenu producteur. Au temps de son fonctionnement, le FDATIC disposait d’un budget annuel de 200 millions de dinars, soit 1,3 million d’euros, ce qui est très peu. Plusieurs films ont bénéficié du CADC, comme La Dernière Reine (Damien Ounouri, 2022), De nos frères blessés ( Hélier Cisterne, 2022), Sœurs ( Yamina Benguigui, 2020 ), et il n’est pas rare que certains longs métrages de fiction tournés en Algérie soient entièrement financés par le CADC pour un montant dérisoire. C’est ainsi que le deuxième long d’Anis Djaad, Terre de vengeance, en compétition à Oran (où il a remporté le prix de la critique, tandis que son acteur principal, Samir El Hakim a obtenu le prix d’interprétation), a entièrement été produit avec les 150 000 € du CADC, sans que le film, fort beau, en souffre dans son écriture ou ses choix esthétiques. Si le dernier Merzak Allouache, Mena, a aussi été tourné avec ce montant, rares sont les cinéastes qui peuvent faire un long métrage de fiction à ce prix, dans de telles conditions, alors que les aides, revues à la baisse, pouvaient aller auparavant jusqu’à 300 000 €. C’est pourquoi en Algérie, seulement dix longs métrages sont produits par an, en incluant les documentaires. Cela dit, si financer le cinéma est une chose (reste à savoir comment le FDATIC va fonctionner à nouveau, avec quel budget), il faudrait que le reste suive, ce qui est loin d’être le cas. On dénombre 13 écrans en Algérie, répartis sur trois villes (Alger, Oran, Annaba), dont seulement 6 salles exploitées commercialement. La fréquentation annuelle est de 300 000 entrées, ce qui rend l’économie du cinéma très fragile, sauf si l’État finance tout. En raison de la faiblesse du parc des salles et de la fréquentation, dur de lever des fonds privés, à moins de viser le marché international via des coproductions. Ce qui reste possible pour des films d’initiative française en lien avec l’Algérie ( voir Omar la fraise d’Elias Belkeddar, 2023 ) et plus rare en Algérie ( voir Algiers de Chakib Taleb-Bendiab, thriller urbain sous influence Netflix qui représente l’Algérie aux Oscars), où le métier de producteur en tant que tel (interlocuteur artistique dès la préparation et recherche de financements) demeure, dans le passage du tout-État à une cinématographie en piteux état, le maillon faible. Le cinéma algérien, outre un vivier d’acteurs impressionnant, compte de nombreux cinéastes de qualité, mais ils ont du mal à faire entendre leur voix. Parmi la jeune génération, Hassen Ferhani, qui fait figure d’aîné ( le magnifique Dans ma tête un rond-point, 2015 ), n’a plus tourné depuis 143, rue du désert (2019). Damien Ounouri, après ses beaux premiers films, a accompli le grand écart ( La Dernière Reine ) en se lançant dans un cinéma populaire à grand spectacle, sur fond de fresque historique, afin de faire bouger les lignes, ce qui, dans le contexte du cinéma algérien, reste un cas isolé. Des réalisatrices ont émergé: Mounia Meddour (Papicha, 2019), Sofia Djama (Les Bienheureux, 2017), Lina Soualem (Bye Bye Tibériade, 2024). Depuis la découverte du puissant et étonnant Abou Leila (2019), premier long métrage d’Amin Sidi-Boumédiène, on attend avec impatience la suite. Tout comme pour Karim Moussaoui, qui nous avait enchanté avec En attendant les hirondelles (2017). Reste à espérer que la reprise du festival d’Oran, en lien avec la dynamique actuelle affichée, porteuse on l’espère de vrais espoirs, permette à cette génération sacrifiée de s’exprimer à nouveau tout en révélant de nouveaux talents.
Charles Tesson
Anciens Numéros