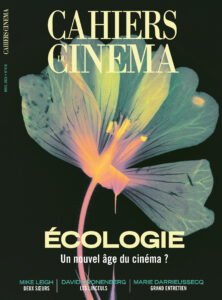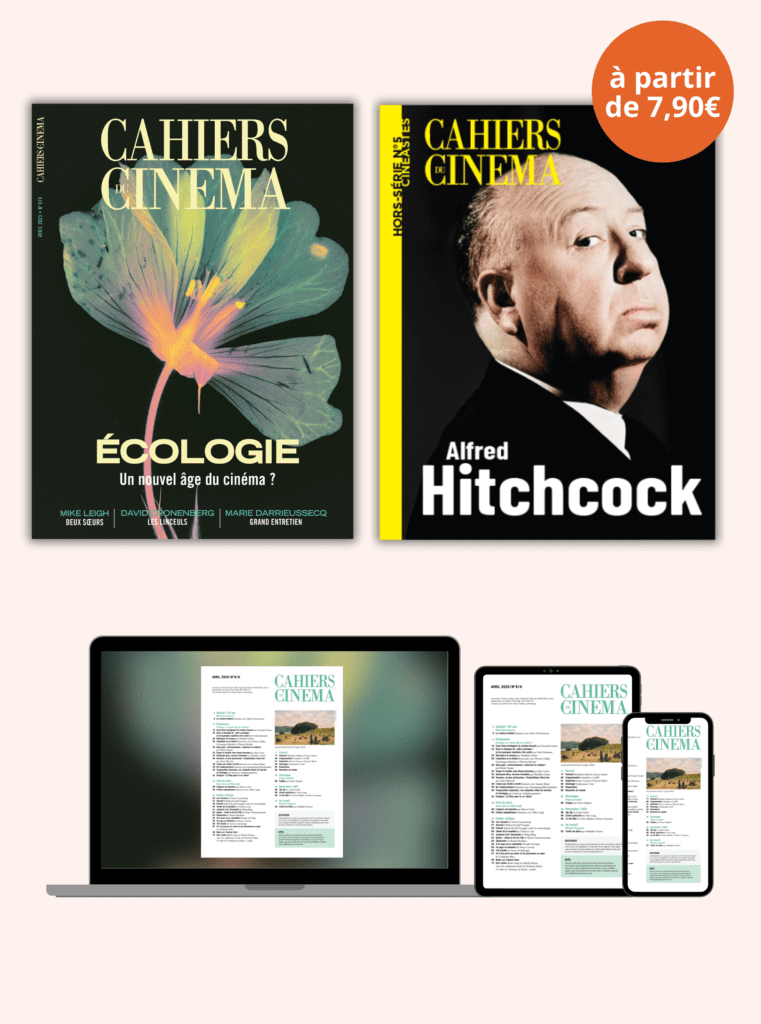ÉCOLOGIE : UN NOUVEL ÂGE DU CINÉMA
MIKE LEIGH : DEUX SOEURS
DAVID CRONENBERG : LES LINCEULS
MARIE DARRIEUSSECQ : GRAND ENTRETIEN
Actualités
Voir tout
25 avril 2025 à 15:00
Laurent dans le vent
À l’occasion de l’annonce de la sélection de l’ACID , découvrez en exclusivité l’entretien des réalisateurs du film Laurent dans le vent, présenté au Festival de Cannes 2025, réalisé par Fernando Ganzo dans les Cahiers n°816.
Les réalisateurs de «Laurent dans le vent» Anton Balekdjian, Matteo Eustachon et Léo Couture
« On a préparé Laurent dans le vent en allant à la rencontre des personnages du film dans plusieurs vallées des Alpes. Tout le long de notre parcours jusqu’aux derniers repérages, on a tenu un journal de bord pour n’oublier aucune interaction, si furtive soit-elle, au moment de l’écriture et de la réécriture du scénario qu’on a pratiquée à trois, en même temps, sur un document partagé en ligne. On voulait que le film soit une rencontre entre des acteur·ice·s et des habitant·e·s du coin, dans une espèce de conte sombre, drôle et réaliste.
Aujourd’hui, 5 décembre, on s’est réveillés tard parce qu’on tourne de nuit jusqu’à ce week-end. On vient de passer le milieu du tournage. C’est “l’intersaison” dans la vallée et pour le film: entre l’automne et l’hiver, entre une partie du tournage en extérieur avec Djanis Bouzyani et beaucoup d’acteur·ice·s rencontrées sur place, et une partie en intérieur avec Baptiste Perusat (toujours), Béatrice Dalle et Thomas Daloz. On finira le tournage à la reprise de la saison dans la station, en équipe réduite, en s’immisçant avec Baptiste parmi les vacanciers, à la manière dont on a tourné Mourir à Ibiza»
Propos recueillis par Fernando Ganzo par courriel, le 5 décembre

Actualités, Alice Leroy, Festival d'Avant-Garde d'Athènes, Festivals
La clef des songes
FESTIVAL. Invitée d’honneur, en décembre dernier, du 13e festival du film d’avant-garde d’Athènes, Antoinetta Angelidi est revenue sur son parcours à l’occasion d’une master class, où la puissance de l’analogie entre peinture et cinéma s’offrait comme la clef d’une oeuvre à nulle autre pareille.
Au creux de chaque plan d’Antoinetta Angelidi se cache une peinture, parfois comme une citation, plus souvent comme une cicatrice. C’est un tableau de René Magritte qui, en 1972, alors qu’elle terminait ses études d’architecture, la convainquit de devenir cinéaste. La Clef des songes, comme La Trahison des images, lui était alors apparu comme un rébus d’images et de mots manifestant une douleur inexprimable. Puisque Magritte dissimulait dans ses tableaux des tragédies intimes – la mort de sa mère et l’avortement de sa compagne –, il devenait possible de raconter le cauchemar de l’enfance dans ses propres images.
Dès son arrivée à Paris, où elle s’exile pour échapper à la dictature et étudier à l’Idhec, le cinéma est une matrice de démontage et remontage introspectif de la peinture classique et moderne. En France, Angelidi rencontre la deuxième vague du féminisme, la psychanalyse de Luce Irigaray, et la sémiotique de Christian Metz. Toutes ces influences se trouvent enchevêtrées dans son film de fin d’études, Idées fixes/Dies Irae (1977), essai de déconstruction du genre qui évoque un remake godardien de la série de John Berger Ways of Seeing sur la BBC. Sauf qu’Angelidi travaille moins à la critique des images qu’à l’exploration de leur inconscient. Avec Topos (1985), inspiré par un autre peintre surréaliste, Giorgio de Chirico, dont une enfant au cerceau a quitté la toile pour rejoindre le film, on entre dans le régime de l’allégorie. Le film tout entier est devenu un palimpseste d’images, avec une femme en armure empruntée à Leonor Fini, une mise en scène invoquant Le Rêve de sainte de Ursule de Carpaccio, ou des corps bleutés tout droit sortis des toiles de Balthus. Traversés par ces tableaux puissamment oniriques, les films d’Angelidi ne cesseront plus jamais d’explorer les paysages inquiétants de la féminité.
Alice Leroy

24 avril 2025 à 11:00
Guillaume Brac, terrains d’entente
RENCONTRE. Guillaume Brac est l’un des cinéastes les plus proches de ce qui pourrait être une école française de la nature. Ses deux films en salles ce mois-ci (lire page 67) laissent s’énoncer clairement une conscience écologique.
Ouverts aux averses, tournés la plupart du temps en extérieur et dans un lieu unique, les films de Guillaume Brac s’articulent autour de milieux plutôt que de paysages, entièrement dédiés aux relations que les humains entretiennent entre eux et avec une certaine portion d’espace. « Chacun de mes films est très ancré dans un territoire, confirme-t-il. Mon rapport à l’écologie se joue à la fois dans la légèreté de mon équipe et des moyens techniques que j’emploie, et dans cette échelle locale ; je ressens le besoin de filmer les habitants, y compris dans mes fictions, car un lieu sans humain n’a pas beaucoup de sens à mes yeux. » Ce rapport d’intimité à l’espace implique le réalisateur lui-même : « J’ai besoin d’avoir vécu des choses dans un lieu pour avoir envie de le filmer, et même pour me sentir en droit de le faire. On pourrait parler d’écologie du regard : cela consiste à prendre le temps de regarder ce qu’il y a autour, et à y trouver de la beauté ; elle peut être ingrate, âpre, mais il y en a presque toujours. Avant le tournage de L’Île au trésor, j’avais passé des journées entières, plusieurs mois durant, à simplement regarder la base de loisirs de Cergy-Pontoise, à me laisser traverser par tout ce qui s’y passait, jusqu’aux lumières et aux sons, comme si je filmais déjà. »
Si les émois des personnages sont catalysés par les lieux où ils séjournent, c’est parce qu’un état général de vacance le permet : « En vacances, on sort d’un rapport d’utilité et d’efficacité au temps et au lieu, pour lui préférer un rapport plus contemplatif et plus poreux à ce qui nous entoure ; les journées peuvent durer, les séquences aussi. » Les titres des films renvoient pourtant à l’imaginaire enfantin de la conquête aventurière, comme le documentaire Le Repos des braves qui, dans un versant plus sombre, suit des cyclistes à la retraite repoussant leurs limites dans une confrontation douloureuse aux reliefs alpins. « Mon rapport à l’espace, et même au fond au cinéma, a longtemps été déterminé par ma pratique du cyclisme, confie Brac. Quand on est sur un vélo, outre découvrir des territoires et s’offrir des moments de contemplation, on conquiert l’espace, ce qui coûte de l’énergie. J’ai eu le sentiment d’avoir grandi dans une bulle sociale assez privilégiée, et j’ai toujours eu le désir, à travers le cinéma, de m’approprier d’autres lieux, qui ont fini par rebattre les cartes de mon identité. S’il y a quelque chose à conquérir, ce n’est évidemment pas la nature, mais la possibilité de vivre quelque chose ensemble. » Dans Ce n’est qu’un au revoir, tourné à Die, dans la Drôme, une pensée politique est, pour la première fois chez Brac, explicitement formulée par les adolescents, qui contrairement aux personnages de ses autres films ne viennent pas de la ville : « Ils ont un accès et un rapport à la nature autres que les adolescentes d’Un pincement au coeur, qui ne cessent de répéter qu’elles n’ont nulle part où aller excepté le centre commercial. J’avais envie de montrer ces deux jeunesses, et d’adopter un autre regard que celui des personnages d’À l’abordage, qui étaient, comme moi à l’époque, des urbains. Je vis désormais dans la Drôme, et souhaitais épouser le point de vue de ces jeunes gens qui ont été façonnés par ce territoire. Le sujet principal est pour moi le rapport entre les générations : Jeanne fait part de son angoisse écologique mais celle-ci s’articule à la relation difficile qu’elle a avec ses parents, et plus généralement avec leur génération qui laisse la suivante se débrouiller dans ce monde abîmé. Je venais moi-même d’avoir deux enfants : sans l’avoir prémédité, sa parole rejoignait pleinement mes préoccupations. »
Mathilde Grasset
Propos recueillis en visioconférence, le 3 mars.

Actualités, Critique
La Chambre de Mariana d’Emmanuel Finkiel
La Chambre de Mariana d’Emmanuel Finkiel (2024)
Un mois après La Cache de Lionel Baier, construit autour de l’interstice où s’était dissimulé un père de famille juif pendant l’Occupation, La Chambre de Mariana semble présenter le revers de ce vide tenu secret longtemps après. Ici, le réduit où l’enfant (inventé par Aharon Appelfeld à partir d’un matériau autobiographique) trouve refuge dans le Czernowitz occupé de 1942 apparaît moins comme un repli de l’histoire que comme un lieu imposant au film ses dimensions. Si ce placard est vivable, c’est qu’Hugo (Artem Kyryk), juif confié par sa mère à une amie non juive, va bientôt en étendre les limites aux murs d’une chambre. Mariana (Mélanie Thierry, qui a appris l’ukrainien pour ce film), prostituée affectueuse, a l’audace de loger ce gamin dans la mai- son close où elle vit et travaille, malgré une maquerelle et un tenancier qui n’ont aucune envie de jouer les Justes. Emmanuel Finkiel se concentre moins sur le quotidien de l’établissement ou le destin singulier des Juifs ukrainiens que sur la façon dont la relation avec Mariana maintient Hugo dans la vie. Au suspense (sera-t-il découvert ? quand pourra-t-il sortir ?) se substitue une durée ductile qui rend la question spatiale obsédante, pour le cinéaste comme pour le personnage. Le premier ménage des brèches pour rendre la pièce poreuse au monde. Le second étend à des dimensions vivables l’étroitesse d’un tombeau, tâche qui se révèle aussi celle de son hôte, presque aussi confinée que lui, usée par l’alcool et les rapports forcés avec l’occupant. Peu à peu, les souvenirs en images et en sons du passé familial d’Hugo s’effacent sous ceux d’une sexualité dont il est témoin. Moins inspiré une fois que le garçon s’aventure au-dehors, Finkiel réussit dans cette deuxième partie un geste risqué : l’enfant dont l’environnement visuel a été restreint pendant des années affronte à peine sorti la vue insoutenable d’un charnier. Elle surgit et brûle comme si c’était le premier contrechamp du film. Et même, le seul.
Charlotte Garson

Actualités
Reprendre terre
PROGRAMMATION. Du 23 avril au 13 juillet, le Forum des images accueille le cycle de la Cinémathèque du doc/BPI, « Outsiders : Rebelles, excentriques, visionnaires », où le documentaire embrasse des existences hors norme.
Filmer des vies aux marges de la société, à sa périphérie ignorée ou méprisée, revient souvent à parier sur sa propre curiosité, à la mettre en jeu, au risque du voyeurisme. On n’en trouvera pas l’ombre dans cette programmation, préparée par Olivia Cooper-Hadjian (membre du comité de rédaction des Cahiers, ndlr) et placée sous l’égide des portraits d’artistes de Marie Losier (The Ontological Cowboy, 2005 ; Barking in the Dark, 2025), éperdument épris de leurs modèles, moulés sur leur extravagance et leur folie créatrice. Plus qu’un thème ou un territoire à défricher, la marginalité devient ici une énergie libératrice, capable d’entraîner dans son sillage le regard approbateur des cinéastes.
L’ethnographie de la marge n’est donc pas au menu, même dans The Moon and the Sledgehammer de Philip Trevelyan (1971), où la famille Page, vivant sans électricité au milieu des bois aux abords de Londres, porte quasiment en bandoulière son étrangeté anachronique. Si l’isolement du groupe évoque Grey Gardens des frères Maysles et son duo malsain mère-fille, le film a quelque chose de plus innocent. Ni hippies ni décadents, les Page luttent avec les moyens du bord pour le maintien d’un mode de vie rural : à les voir rafistoler des machines à vapeur, on dirait que c’est la marche même de l’histoire qu’ils essaient de freiner, avec un entêtement enivrant. Les amateurs du cinéaste Ben Rivers y retrouveront une influence indéniable : son court métrage Ah, Liberty (2008), programmé lui aussi, est emblématique du déboussolage temporel qu’il tire à son tour de simples jeux d’enfants, dans un monde où la nature et les déchets humains semblent faits du même bois.
Après les derniers chasseurs cueilleurs du Sussex, Nuestra voz de tierra, memoria y futuro des Colombiens Marta Rodríguez et Jorge Silva (1981) montre une communauté expulsée de ses terres et bien décidée à les reprendre. Du cinéma indigène et décolonial avant l’heure, qui inclut dans sa fabrication les voix et la cosmogonie d’un peuple pour attaquer l’histoire officielle sur un terrain aussi politique qu’esthétique. De quoi déranger une nouvelle fois le partage entre l’ancestral et le moderne : aux séquences d’organisation syndicale se heurtent des visions assimilant les propriétaires blancs à un diable à cheval (l’usurpation culturelle s’insinue donc jusque dans les cauchemars), rendues d’autant plus inquiétantes par le décompte des morts dans la réalité.
Programmés ensemble, Sandrine à Paris de Solveig Anspach (1992) et Blue Boy de Manuel Abramovich (2019) redescendent à l’échelle intime des visages scrutés pour y déceler l’étincelle mutine, le repli souverain : qu’il s’agisse d’une ex-pickpocket invitée à confier ses « bêtises » et racontée elle-même, en parallèle, par des témoins compréhensifs, ou de jeunes escorts roumains écoutant leur propre récit sous la lumière rose bonbon d’un bar berlinois, le portrait devient l’art de filmer la rébellion tranquille d’un sujet qui se sait pris dans les phares du jugement social.
Il faut enfin voir L’Exil et le Royaume, d’Andreï Schtakleff et Jonathan Le Fourn (2008), l’une des plus belles redécouvertes du cycle. Cela se passe à Calais, à une époque où il n’était pas encore question de « jungle », mais où le parcours des réfugiés vers l’Angleterre comptait déjà sa longue histoire de morts, de traques, de centres d’hébergement rasés. On pourrait s’étonner qu’au lieu de se tourner vers les migrants eux-mêmes, le film les laisse longtemps dans l’ombre, au bénéfice de portraits de citoyens en mission, résistants d’un nouveau siècle ; c’est pourtant ce parti pris qui en fait toute la force, puisque l’existence même de l’aide et du soin était (et demeure) elle-même invisible, jamais montrée : il est supposé, ici, que les nuits des uns et des autres ne s’opposent pas.
Élie Raufaste
Offres d’abonnement
Les évènements passés
Agenda CinéphilePas de quoi être fiers
Parmi les polémiques qui ont récemment entaché la campagne d’Emilia Pérez pour les Oscars, celle qui concerne sa représentation du Mexique est particulièrement intéressante. L’inconséquence politique du geste d’Audiard est d’autant moins à prendre à la légère que la réaction au Mexique ne se manifeste pas que dans quelques éditoriaux ou critiques ; elle a provoqué la colère jusque dans des salles de cinéma. Pour résumer ce qui est reproché au cinéaste, citons Artemisa Belmonte, dont la mère et trois oncles ont disparu en 2011 à cause de la narco-violence, et qui est à l’origine d’une pétition contre le film : « Les acteurs chantent et dansent sur la violence et la corruption dans notre pays, sur la cruauté des trafiquants de drogue, et même sur la façon dont ils se débarrassent des corps de leurs victimes. » On pourrait lui répondre que ça n’est qu’un film, et que la narco-violence n’est pas le sujet d’Audiard, ce que fait Michel Guerrin dans un éditorial publié dans Le Monde le 7 février : « On fait un sale procès à Jacques Audiard, tant Emilia Pérez ne dit rien du Mexique, de la même façon que la série Emily in Paris ne dit rien de la capitale. » Sauf que 30 000 morts et 100 000 disparus par an ce n’est pas tout à fait le même sujet que les stéréotypes sur Paris ou la proverbiale mauvaise humeur de ses habitants. Guerrin oublie un autre élément essentiel, c’est que le Mexique n’est pas du tout la France en termes de représentation : il y a dix mille autres images de Paris que celle d’Emily in Paris chaque année sur les écrans, mais bien peu du Mexique. Cette domination par l’image – où les stéréotypes redoublent l’invisibilité – participe bien sûr d’autres dominations, notamment celle des États-Unis dont le président est extrêmement hostile au Mexique, qu’il réduit précisément à sa violence.
Le risque, pourrait-on nous opposer, serait de n’attendre du cinéma qu’une représentation réaliste et documentée. Mais ce n’est pas l’imaginaire en soi qui est remis en cause dans ces critiques du film d’Audiard. On sait combien l’opératique ou l’exotisme ont été des éléments essentiels de l’histoire du cinéma à l’heure de filmer des contrées lointaines. Mais nous ne sommes plus en 1930, où l’on pouvait encore rêver à des territoires éloignés, parfois vierges de cinéma, dont remontaient des images pétries de fantasmes coloniaux. Et surtout, le vrai exotisme était formaliste : il se nourrissait d’esthétiques et d’imaginaires étrangers, dans une réinvention qui n’était pas juste une appropriation, mais qui relevait d’une vraie connaissance et d’une fascination (Gauguin ou Sternberg, par exemple). Un cinéaste est encore travaillé par cette question : Miguel Gomes, dans Tabou et Grand Tour, en particulier. Il est l’antithèse d’Audiard, parce que l’exotisme est pour lui une sorte de moteur poétique qu’il va mettre à l’épreuve dans le voyage. Il sait que ce n’est pas en allant au Mozambique ou en Birmanie qu’il cessera d’y être étranger, mais il assume ce jeu entre la rêverie romanesque de l’ailleurs et la réalité des lieux. C’est toute la différence entre le cliché, qui s’accapare, réduit et aveugle, et une forme de déterritorialisation de l’imaginaire, qui fraye des voies inconnues, ne demande qu’à se perdre.
Dans sa défense d’Audiard, Guerrin pousse sa démonstration jusqu’à accuser les Mexicains offensés par Emilia Pérez de patriotisme : « Ce procès [en appropriation culturelle] se double désormais d’une dimension identitaire, voire nationaliste. » Pénible raccourci où la colère d’une population n’est pas perçue dans son sens politique, pourtant précisément exprimé, mais à travers un procès d’intention qui retourne l’offense en douteuse agression. À propos de patriotisme, on pourrait mettre en face de ce prétendu nationalisme tous les articles et messages de professionnels de la profession ou d’hommes politiques exprimant la fierté pour la France qu’Emilia Pérez soit nominé à tant d’Oscars. Ce cocorico pour quelques statuettes n’est-il pas quelque peu indécent face à l’état de la culture dans notre pays ? La gloire à Hollywood d’un seul film, quoi qu’on en pense, ne pèse absolument rien face au scandale des coupes budgétaires catastrophiques récentes (100 millions d’euros en décembre) ou de celles qui s’annoncent, et les nombreux emplois, lieux culturels et festivals qui s’en trouvent menacés. Vraiment pas de quoi être fiers.
Lire plus6,90 € - J'achète ce numéro
Anciens Numéros

La librairie des Cahiers
Découvrir