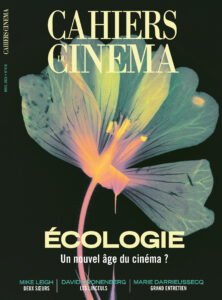Actualités, Festival Écrans Mixtes, Festivals
Do it yourselves
FESTIVAL. Du 6 au 13 mars, deux semaines après que le drapeau arc-en-ciel du centre LGBTQIA+ de Lyon a été une nouvelle fois arraché, le festival Écrans mixtes faisait salle comble en transmettant de plus belle la vivacité des imaginaires queer.
Avec un jury présidé par la productrice Christine Vachon et une nouvelle section destinée aux films autoproduits ou à petits budgets, cette édition mettait l’accent sur les modalités concrètes de fabrication des cultures queer plus ou moins marginalisées. Le Paris des années 1990 des premiers films d’Anna Margarita Albelo y rimait affectueusement avec celui de Zoé la boxeuse et Pigalle, premiers court et long métrages de Karim Dridi, qui croisaient aux mêmes comptoirs acteurs et actrices professionnels, gangsters à la retraite, travailleuses du sexe, fiction et cinéma-vérité, saisissant le burlesque et le tragique sous les mêmes néons. Tandis qu’Albelo présentait sa « plus petite boîte de production du monde » dans une master class, ces logiques alternatives de production se reflétaient aussi bien dans l’urgence des prises de vues mi-caméra mi-téléphone d’Éviction, documentaire de Mathilde Capone sur le DIY social et immobilier des habitant·e·s d’un lieu de vie communautaire montréalais ciblé par une prochaine « rénoviction », que dans l’importance accrue donnée aux courts et moyens métrages. Plusieurs d’entre eux assumaient un plaisir du (bri-)collage visuel et du mélange des genres, dont le teen movie apocalyptique lesbien My Heart Is going to Explode (Jung Inhyuk) poussait assez loin la réflexivité amusée, appelant surtout la sympathie du public par ses détournements loufoques. Dans la section Panorama, le très beau Cabo Negro (Abdellah Taïa) faisait vivre une autre maison cinéma, la villa marocaine que Soundouss et Jaâfar ouvrent doucement aux quatre vents en attendant l’amant de ce dernier, qui ne vient jamais. En compétition, deux portraits d’artistes exploraient les plasticités du journal reconstitué, via les archives DV de la·e chanteur·euse du groupe postpunk Glue dans The Life of Sean DeLear (Marcus Zizenbacher) et le photomontage parlé des oeuvres de la photographe tchèque Libuše Jarcovjáková dans I Am (Not) Everything I Want to Be (Klára Tasovská).
Circé Faure

Actualités, Festivals, La Berlinale
Berlin, à mots couverts
FESTIVAL. Pour apaiser les craintes à la suite du départ de Carlo Chatrian, la première Berlinale dirigée par Tricia Tuttle s’est voulue rassurante quant à son ambition artistique et politique. Mission réussie ? À l’image d’une météo unissant neige et soleil, cette 75ᵉ édition était faite de contrastes.
On reconnaîtra le discernement du critique au fait qu’il s’est dispensé de prendre des notes sur un seul des films en compétition vus : le lauréat du prix suprême, Dreams. À partir d’un récit de premier amour fait par une adolescente, le Norvégien Dag Johan Haugerud y travaille l’écart entre le réel et son élaboration littéraire, mais son intelligence ne se départit jamais d’un certain confort esthétique et social, entre session de lecture et de thérapie, boule à thé et pull en laine. Plus que dans le ronronnement de cet Ours d’or, dans des films repliés sur des enjeux familiaux (What Marielle Knows de Frédéric Hambalek, If I Had Legs I’d Kick You de Mary Bronstein, Mother’s Baby de Johanna Moder) ou sortis d’une éprouvette cinématographique (La Tour de glace de Lucille Hadžihalilovic), la liberté et l’ouverture se trouvaient dans les images filmées au portable ou basse définition (tendance floue) de Radu Jude et Hong Sangsoo. Autour de la rencontre du poète Donghwa et de la famille de sa petite amie, le dernier opus de l’inépuisable Coréen scrute les interactions sociales tout en s’inclinant doucement vers une dimension conceptuelle. À commencer par la voiture et la moustache du poète, attributs et attitudes sont sans cesse commentés, tandis qu’un jeu de répétitions, de glissements et de retournements se met en place sous le découpage en huit chapitres. Il y a en effet loin de la première impression à la dernière, et What Does That Nature Say to You, avec son titre en forme de question sans point d’interrogation, s’amuse avec minutie de la variabilité et de la partialité des jugements. Les caractères y sont définis et changeants, la nature à la fois admirée et hostile. Partageant avec Hong Sangsoo un art du plan-séquence (imbibé de whisky plus que de thé), Richard Linklater investit à sa manière le hiatus entre le réel et ses habits de paroles.
Adaptant avec Blue Moon une pièce mettant en scène Lorenz Hart (formidable Ethan Hawke) le soir de la première triomphale d’Oklahoma!, composé par son ancien partenaire Richard Rodgers, Linklater donne au métier de parolier un tour existentiel. S’enivrant d’alcool et de paroles incisives, Hartz, déclinant petit homme (la mise en scène joue des contrastes physiques), manie le langage comme l’instrument jouissif d’une inflation imaginaire. Si l’abattage linklaterien contraste avec le tempo hongien aéré, les films trouvent chacun une harmonie complexe : le premier est à la fois plus comique et plus mordant que ses précédents, et Blue Moon aussi savoureux que mélancolique.
Traversées présentes et futures
El Mensaje, de l’Argentin Iván Fund (Prix du jury), privilégie le silence. Appuyé sur le don télépathique permettant à la jeune Anika de communiquer avec les animaux, la grâce du film tient au parti pris de résorber tout questionnement sur la vérité de ce pouvoir et sur le passé des protagonistes qui en font commerce pour s’en tenir à l’observation de l’itinérance quotidienne du trio formé par Anika, sa mère et son beau-père. Dans un rapport ambivalent à son titre, El Mensaje creuse le lien des individus aux autres (humains et non-humains), alliant recherche de sens et sensibilité aux formes pures (à l’image d’une danse lumineuse d’insectes), profondeur de l’invisible et immanence des corps. The Blue Trail de Gabriel Mascaro (Grand Prix du jury) propose aussi une autre trajectoire mâtinée de fantastique, mais moins épurée. Le regard porté sur la fuite de la septuagénaire Tereza le long de l’Amazone est plus haut en couleur. De lavage en massage, jusqu’à une danse avec une autre aînée et amie, il séduit par son attachement désirant au corps. En situant son action dans un futur dystopique mais pas si lointain où le gouvernement brésilien décide du déplacement des personnes de plus de 75 ans dans des « colonies », il apporte également un élan politique rassérénant. Laissant derrière soi travail et famille, Tereza contraste avec le trentenaire d’Ari de Léonor Serraille dont l’anxiété face à l’état du monde trouve une réponse dans la paternité. Quitte à se pencher sur le désespérant état du monde, autant en rire. Kontinental’25 de Radu Jude (lire Cahiers no 816), mise à jour d’Europe 51, scrute la crise d’une huissière, Orsulya, après le suicide d’un homme exproprié. Contrairement à ce qui se passe chez Rossellini, la conscience de la déshumanisation et d’un nationalisme ambiant échoue ici à transformer le personnage. Dans un enchaînement de rencontres en longs plans fixes, Orsulya se cherche à travers des discussions qui tournent à vide. S’il ne faut pas trop attendre de la fin du monde, c’est que les individus ont définitivement perdu le sens de l’histoire, que le cinéaste laisse pourtant transparaître dans les vues de la ville transylvaine de Cluj qui ponctuent son film, montrant la violente métamorphose urbaine en cours et la coexistence des époques. Kontinental 25 se compose en pot-pourri lucide où se nouent l’immobilier, la politique et la morale.
À la veille d’élections allemandes marquées par une avancée de l’extrême droite, le festivalier a pu se tourner vers quelques documentaires des sections parallèles pour mieux appréhender les racines de ce contexte national. Entre archives et présent, le split-screen de Pride & Attitude de Gerd Kroske ausculte ainsi une cicatrice historique : les paroles de femmes de l’ex-RDA employées dans les industries minières et chimiques évoquent le tournant de la réunification, la fierté pionnière et l’imaginaire du progrès collectif heurtés par le chômage et la division. En accompagnant pendant quatre ans les familles des victimes de crimes racistes commis à Hanau en 2020, Das Deutsche Volk de Marcin Wierzchowski confronte le besoin de transmission d’une mémoire et de valeurs (notamment par la construction d’un monument) à la retenue des institutions juridiques et politiques. Soucieuses de ménager les responsables en place et les électeurs, celles-ci s’adaptent au statu quo plutôt que d’assumer de justes décisions. De quoi se rappeler que la politique, affaire de parole, relève aussi de la manière dont on se saisit en actes d’un espace et d’un temps, que ce soit dans un film, un festival, ou dans le réel. Espérons donc que la prochaine Berlinale, selon les mots de Radu Jude, «ne s’ouvre pas sur Le Triomphe de la volonté ».
Romain Lefebvre

Actualités, Critique
Sûre mesure
Jeunesse (Les Tourments) de Wang Bing (2024)
On n’a peut-être jamais vu la première partie, ou saison (Le Printemps), de Jeunesse. On a peut-être rêvé l’avoir vue, puisqu’ici tout recommence, presque à l’identique. Retour aux ateliers textiles de Zhili, quartier environnant mais invisible, limité aux immeubles dans lesquels, de nouveau, la caméra de Wang Bing circule en vase clos, la moindre embardée dans la rue tenant de l’incursion périlleuse. Avec les lieux, reviennent leurs occupants, jeunes et moins jeunes ouvriers exilés des campagnes occidentales de la Chine : leur nom et leur âge se surimpriment toujours à l’écran, associés à leur village et province d’origine. Après le premier chapitre, qui s’achevait sur le retour d’un couple au pays, ces rappels toponymiques prennent toutefois une autre épaisseur, ils lorgnent vers une image latente, les lointains paysages que les travailleurs regagneront là encore, après un long confinement (plus de trois heures à l’écran, des mois dans la réalité). Puissants décrochages qui prouvent combien la longue durée est tout, chez le cinéaste, sauf une signature ou un « format » visé pour lui-même : ici, le montage des masses temporelles répercute le déphasage intime de l’exil.
Les Tourments apparaît en fait comme une séquelle du Printemps, une suite qui dégénère. Leurs structures se ressemblent tout comme se ressemblent les scènes de négociation de salaire, les gestes machinaux des ouvriers, les tissus pliés et repliés (le film s’ouvre sur une histoire d’ourlets), façon toile de Pénélope. Wang ne craint pas la redondance, parce qu’il ne considère pas, chose rare dans le documentaire, que le réel se réduise à un éventail de situations exemplaires. Il esquisse des portraits, traque ce qui varie dans l’invariable, l’accroc, le trou, l’événement. Or dans Les Tourments, les événements les plus graves sont invisibles. On y signale plusieurs disparitions : après le livret de paie d’un garçon désemparé, c’est au tour d’un patron endetté de s’évaporer dans la nature en ayant, au passage, tabassé un fournisseur. L’incident, qui éclate dans la rue, crée une sorte de dépressurisation, il aspire le tournage depuis le dehors : posté auprès des ouvriers, le cinéaste « rate » la scène, puis enregistre son infini après-coup, une cascade de déboires se perdant aux confins des jours et des nuits.
À côté des stratég ies de survie (revendre les machines pour se payer un minimum, plutôt qu’espérer un geste de l’État), le film documente alors le temps ahuri de l’abandon, du déboussolage. Le temps du débat moral existe, mais il est bref, le scandale se périmant vite dans un lieu où parler signifie ralentir, freiner la cadence : « Ça cause, mais faut bosser aussi », souffle-t-on en coulisses. Menacent donc l’effritement de la colère, l’accoutumance à la marche des choses. On apprend que les fuites de patrons ne sont pas rares. L’événement s’effiloche, reflue à l’état d’anecdote. La concurrence au sein d’un même atelier étouffe la possibilité d’une grève. C’est le moment que Wang Bing choisit pour créer un contrepoint minuscule et implacable. Au bord de l’inertie, il perce un trou, mais dans le dispositif : alité dans le noir, un homme lui parle directement, un peu comme le faisait Fengming, survivante des camps de travail, dans Fengming, chronique d’une femme chinoise (2007). Il lui raconte la révolte du quartier en 2011 lors de la mise en place d’une taxe, puis la répression policière, brutale, lancée contre les travailleurs migrants. L’irruption calme, presque rieuse, de ce témoin nocturne est aussi inattendue que les feux d’artifices allumés par un père fêtant le retour de son fils à la campagne : ainsi la « vitalité extraordinaire » des sujets filmés, saluée par le cinéaste dans un carton final, paraît-elle d’autant plus surprenante lorsqu’elle surgit, infime et pétaradante, au détour d’un plan-séquence.
Élie Raufaste
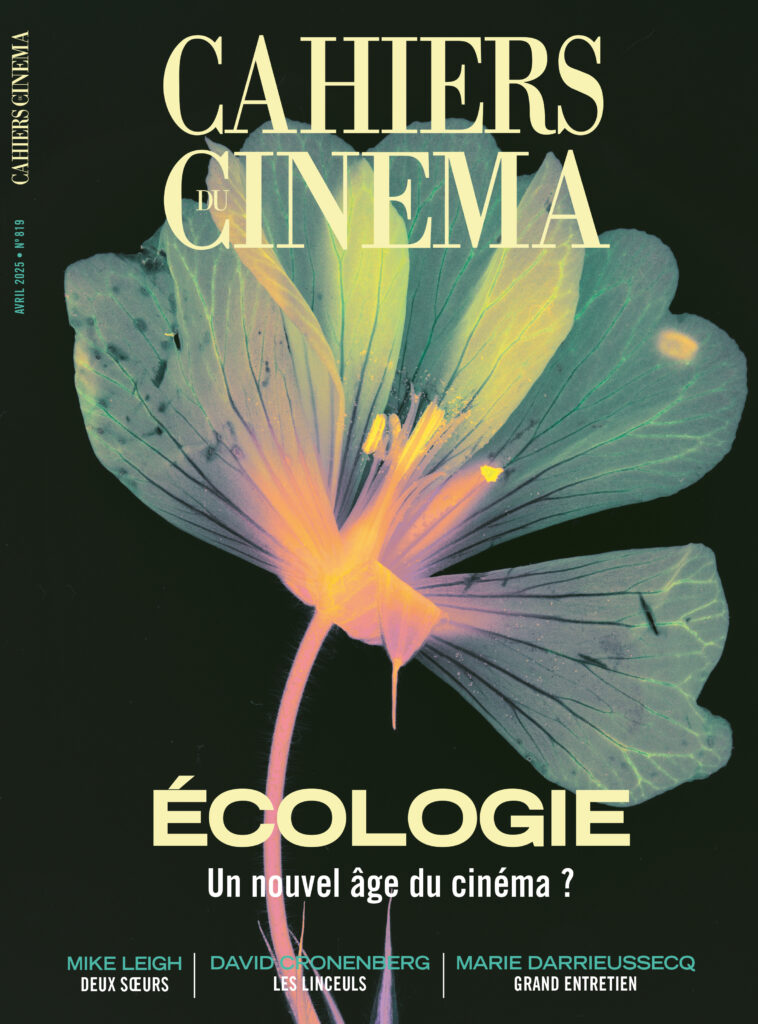
Editos
L’urgence d’être patient
Parce qu’il a permis d’enregistrer la vie des humains dans leur environnement, qu’il a été instrument d’exploration et de science autant que de rêve, parce qu’il a pu imaginer toutes formes de catastrophes, de fins du monde, de dominations de l’homme par d’autres espèces, ou réinventer les proportions naturelles (un gorille grand comme un building, un homme réduit jusqu’à l’infiniment petit…), le cinéma a d’une certaine manière toujours pensé l’écologie. Et depuis les années 1950, il a accompagné par des fables toutes nos peurs en la matière : des radiations atomiques à la disparition de l’humanité, en passant par une multitude de déluges. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup de cinéastes aient fait preuve d’une conscience écologique lorsque celle-ci est devenue une question politique fondamentale. C’était dans le prolongement évident de leur manière de penser le paysage, la nature, notre place sur terre que Robert Bresson, Jean Rouch, Éric Rohmer, Luc Moullet ou Jean-Marie Straub et Danièle Huillet ont très tôt pris position sur ces questions. On se rend compte aujourd’hui combien ils étaient précurseurs, alors que beaucoup les prenaient pour des naïfs ou des ronchons excessifs.
On se souvient, par exemple, de Straub et Huillet dénonçant à propos de l’incendie final d’Apocalypse Now l’indignité d’un cinéaste capable de sacrifier une forêt pour une scène. Parmi les prises de conscience de la violence exercée sur la nature par des tournages, les plus évidentes furent celles où il y avait une contradiction flagrante entre ce que célébraient les films et leurs conditions de production. Par exemple, Louisiana Story de Robert Flaherty (dont, déjà, Nanook l’esquimau était financé par l’entreprise de fourrure Revillon Frères), qui se présente comme un film d’exploration des bayous à travers le regard d’un enfant, mais qui est au fond une publicité pour la société pétrolière Standard Oil, productrice du film. De même, le mythe du commandant Cousteau a été quelque peu écorné par ce que nous avons appris depuis du tournage de certaines scènes du Monde du silence, où furent massacrés des requins, lacérés des cachalots, détruits des récifs de corail, entre autres. En parler des décennies plus tard, c’est se réjouir que ce qui paraissait acceptable à une époque ne l’est plus du tout aujourd’hui. Car les cinéastes qui aiment véritablement filmer la nature et la vie sous toutes ses formes ne sauraient concevoir qu’un tournage nuise à ce qu’ils contemplent. Cela ne relève pas d’une vision candide mais au contraire d’une conscience aiguë de la violence et de l’offense en jeu. En ce sens, comme le suggère un intervenant dans le reportage qui ouvre notre dossier, la révolution écologique qui gagne les tournages de films n’est pas sans rapport avec le mouvement MeToo.
S’il fallait citer un cinéaste exemplaire dans sa façon de lier écologie, économie et esthétique, ce serait probablement Éric Rohmer. On repense bien sûr au monologue de l’instituteur interprété par Fabrice Luchini dans L’Arbre, le Maire et la Médiathèque face à l’arbre très ancien que l’on va couper pour construire une médiathèque dans un champ, dénonçant une certaine conception moderne de l’urbanisme, un faux accord avec la nature, plus hypocrite que le bétonnage. On se souvient aussi du carton au début des Amours d’Astrée et Céladon, expliquant pourquoi il lui avait été impossible de tourner sur les lieux mêmes du roman d’Honoré d’Urfé tant le paysage en question avait changé depuis le XVIIe siècle : « La plaine du Forez étant maintenant défigurée par l’urbanisation, l’élargissement des routes, le rétrécissement des rivières, la plantation de résineux. » Cette conscience du paysage est en parfait accord avec le choix de petites équipes, c’est-à-dire du désir que le tournage se coule dans le monde plutôt qu’il ne s’y impose : être là sans déranger, selon la leçon de Roberto Rossellini. Avec la conscience écologique devra naître une nouvelle économie du cinéma. Voyons-y aussi la possibilité de nouvelles manières de fabriquer et de penser les films : une modestie de moyens libératrice, où le temps n’est pas que de l’argent. Où, comme disait Straub, le vrai génie est la patience.
Marcos Uzal

Actualités
Pour une culture du débat
Entretien avec Agnès Tricoire
Avocate spécialiste en propriété intellectuelle, Agnès Tricoire préside l’Observatoire de la liberté de création, fondé sous l’égide de la Ligue des droits de l’Homme et devenu récemment une association, « lieu de discussion interdisciplinaire et de solidarité entre tous les genres culturels ».
Le Manifeste de l’Observatoire de la liberté de création (2003) rappelle que « l’œuvre d’art, qu’elle travaille les mots, les sons ou les images, est toujours de l’ordre de la représentation. Elle impose donc par nature une distanciation qui permet de l’accueillir sans la confondre avec la réalité¹. » En quoi la décision ou non d’accompagner la projection d’un film d’un débat recoupe-t-elle aujourd’hui les questions de droit que l’Observatoire met en avant depuis sa création en 2003 ?
Quand j’ai proposé à Michel Tubiana, en 2002, de créer l’Observatoire, sous l’égide la LDH, c’était à une période de résurgence de demandes de la censure. Jusque-là, on connaissait les associations d’extrême droite, comme l’Agrif, qui perdait tous ses recours en condamnation contre les œuvres. Le début des années 2000 marque le retour de la demande de censure plus large, contre l’exposition « Présumés innocents » au CAPC de Bordeaux et deux livres accusés d’apologie de la pédophilie, Il entrerait dans la légende de Louis Skorecki et Rose bonbon de Nicolas Jones-Gorlin. Plus tard, avec les manifestations organisées contre l’exposition/tableau vivant Exhibit B au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, on peut considérer que des organisations défendant pourtant des causes progressistes ont emboîté le pas. À l’Observatoire, nous venons tous de disciplines différentes, et nous avons pris le temps de nous mettre d’accord sur les mots pour rédiger notre manifeste de 2003. À l’époque, la liberté de création n’existait pas en tant que telle. Nous y posons la distinction entre fiction et discours réel, et la nécessité, si une œuvre est contestée ou pose problème, d’organiser un débat avec son public.
Qu’en est-il des lois et de la jurisprudence récentes, et de leurs conséquences sur la création ?
La jurisprudence s’est inspirée de notre Manifeste pour distinguer entre fiction et réalité, distinction aujourd’hui bien établie. Nous sommes aussi à l’origine de la loi de juillet 2016 qui protège la liberté de création, de diffusion et de programmation. Le Conseil d’État, pendant le Covid, a décidé que ces libertés de création et de diffusion étaient fondamentales. Pour nous, c’est une victoire supplémentaire. Ces libertés relèvent de la liberté d’expression mais avec les spécificités de la fiction, donc avec leurs particularités; et les sénatrices, quand elles ont travaillé à évaluer cette loi, nous ont interrogés, et à cette occasion nous avons produit une note conséquente, que nous publierons sur notre futur site, qui retrace le paysage législatif concernant les œuvres et formule des demandes d’amélioration de la loi, encore trop restrictive. En parallèle, avec l’éditeur Actes Sud, nous contestons un arrêté de Gérard Darmanin qui a interdit un ouvrage destiné aux ados pour « pornographie », ce qui nous a permis de déposer (via l’éditeur et la LDH) à la fois un recours et une question prioritaire de constitutionalité. En effet, la loi de 1949, permettant de surveiller toute la littérature sous l’égide du ministère de l’Intérieur, qui peut prononcer l’interdiction de la vente et/ou de la publicité des livres, n’est pas conforme aux standards de la liberté d’expression tels que posés par l’article 10 de la CEDH et la jurisprudence de la cour de Strasbourg. Sous François Hollande, nous avons dû intervenir en urgence pour contrer un décret catastrophique donnant les clefs de la censure au cinéma à l’extrême droite. L’association Promouvoir, dirigée par un type qui s’était fait virer du FN par Bruno Mégret pour radicalité, fait des recours fréquents contre les visas pour obtenir un durcissement du classement des films qui ne lui conviennent pas, et y parvient depuis le début des années 2000 (Baise-moi et le rétablissement du moins de 18 ans). C’est ainsi qu’a subi cette interdiction, de façon absurde, Quand l’embryon part braconner de Kôji Wakamatsu, au propos progressiste, très beau film sur une femme qui se rebelle contre le joug qu’elle subit. Face à ces mouvements régressifs, la profession du cinéma, vu les importants enjeux d’argent, essaie d’anticiper, ce qui crée de l’autocensure en amont; cela s’accompagne aussi d’une profonde modification de ce qui est diffusé à la télévision, donc d’un appauvrissement culturel sous couvert de protection de l’enfance.
C’est pour éviter la censure que vous avez envoyé une lettre le 13 décembre au directeur de la Cinémathèque, Frédéric Bonnaud, lui demandant un débat contradictoire après la projection du Dernier Tango à Paris ?
C’était une offre qu’ils auraient dû saisir : nous proposions de coorganiser le débat. J’avais approché Frédéric Bonnaud, sans qu’il ne donne suite, il y a quelques mois. Là, il s’agissait, dans l’urgence, d’une proposition d’animer l’échange en tant qu’Observatoire, ce qui aurait permis aux personnes représentant la Cinémathèque d’être en égalité de terrain avec les gens qui protestaient contre la projection. L’idée est que chacun doit apprendre de l’autre. Les positions de surplomb qui s’abritent derrière des positions purement esthétiques se heurtent à celles qui contestent la programmation des œuvres pour des raisons purement sociétales et ça donne un résultat qui nous semble désastreux et qu’on avait anticipé dans la lettre : ils ont déprogrammé. Parce qu’ils n’ont pas mis la locomotive avant les wagons: diffuser Le Dernier Tango à Paris avec tout ce qu’on sait sur ce qui s’est passé pendant le tournage imposait de faire un débat public permettant enfin qu’un échange ait lieu.
Pourquoi proposer vous-mêmes d’organiser ce débat ?
Parce que nous avons l’expérience du débat et de ses difficultés, et regrettons que, de façon générale, les institutions culturelles n’en aient pas plus l’habitude. Nous savons qu’il faut être fort depuis Exhibit B, où la préfecture décourageait le Théâtre Gérard-Philipe d’organiser un débat pour des raisons d’ordre public. Devant le théâtre, des gens manifestaient (certains avaient cassé la porte dès le premier soir) et le public se faisait insulter… On a été présents tous les soirs pour faire de la médiation avec le public afin que les gens puissent échanger et parler dans ce contexte de violence, et que ceux qui avaient souhaité aller voir le travail de Brett Bayley puissent exprimer ce qu’ils avaient ressenti, en négatif ou en positif. J’avais fait venir des gens qui étaient pour la censure au départ, notamment deux associations s’occupant de la mémoire de l’esclavage aux Antilles, qui ont tout à fait changé de point de vue après avoir vu le spectacle. C’était d’ailleurs un moment émouvant, qui a été précédé d’un long silence, car la visite avait fait remonter des choses extrêmement douloureuses. Le visiteur qui était le plus remonté a priori m’a demandé à la fin si on ne pouvait pas œuvrer à ce que le tableau vivant soit filmé, pour que tout le monde puisse le voir. Ça nous a appris beaucoup, même si on le sait, au fond: les œuvres sont souvent victimes de préjugés. Il est donc essentiel que le débat ait lieu après la prise de connaissance de l’œuvre.
Cette posture privilégiant un échange après avoir vu l’œuvre est-elle contestée dans certains secteurs ?
Il y a des intellectuel·l·es militant·e·s qui soutiennent que le public de l’œuvre est aussi celui qui la conteste sans l’avoir vue. La réponse pour nous, c’est que le public d’une œuvre est celui qui l’a vue et qui peut en discuter.
Cela pourrait-il aussi s’appliquer au cas du Dernier Tango à Paris ?
Ce cas pose une question spécifique, car d’une certaine façon les contestataires de la diffusion de l’œuvre peuvent répondre: on sait déjà ce qu’il y a dedans, on est déjà informé·e·s par les prises de position publiques de Maria Schneider sur ce qu’elle a subi. C’est aussi un débat spécifique car le film ne pose pas seulement problème à cause de son contenu (montrer un viol, que certains considèrent d’ailleurs comme un viol réel alors qu’il reste fictif) mais aussi à cause de la façon dont il a été réalisé et du dommage qui a été fait à son actrice. Pour Exhibit B, aucun comédien ne s’est plaint de ce que des activistes reprochaient à l’œuvre, à savoir que les comédiens auraient été silenciés, car seul leur regard était mis en scène. À la fin de l’installation, il y avait même des textes des comédiens expliquant pourquoi ils avaient voulu participer à cette œuvre. Alors que Maria Schneider, qui n’est plus là pour raconter les choses, a clairement décrit la scène comme un viol symbolique.
Un des arguments pour ne pas le montrer, ou le voir, est qu’une violence effective est là, à l’écran.
Oui, mais le choix de mots n’est pas anodin. On ne peut pas dire que c’est un viol filmé, car l’actrice n’a jamais dit qu’elle a été violée réellement. Mais elle a évoqué la violence qu’elle a subie dans la scène, et on sait que son consentement n’a pas été recueilli pour le tournage d’une scène de viol.
Vous insistez sur l’importance des échanges après avoir vu les œuvres. Dans le cas du cinéma et des séries, il y a aussi une vraie demande d’avertissement: que le spectateur soit prévenu si ce qu’il va voir peut le heurter, une sorte de première contextualisation. Mais comment proposer ces trigger warnings sans que ces informations préalables ne conditionnent le spectateur à accepter ce qu’il va voir, même si ça le heurte, sans le contester ou le mettre en question dans l’échange qui aurait lieu à la fin de la séance ?
Des éléments objectifs de contextualisation factuelle peuvent être donnés avant la séance. Je ne vois pas en quoi ça pourrait rendre le spectateur plus docile, au contraire, cela lui permet de prendre de la distance par rapport à ce qu’il va voir. Mais il faut être très vigilant, et éviter de confondre information et positions de jugement. C’est une question extrêmement complexe dont on n’a pas encore vraiment discuté à l’Observatoire : celle de l’information. Si l’information est nécessaire avant Le Dernier Tango à Paris, de façon évidente, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de la précaution systématique, et se croire obligé de prévenir les spectateurs qu’il y a des scènes « dérangeantes » dans un film. Les œuvres d’art sont aussi là pour nous déranger.
Le fait que la Cinémathèque ait une mission de service public importe-t-il dans la demande que vous lui avez adressée ?
Oui, la lettre le stipule. La Cinémathèque est une association qui vit sur des fonds publics et a des missions de service public. On peut légitimement envisager que l’accompagnement des spectateurs est une nécessité, et qu’une prise de parole purement esthétique quand une œuvre pose un problème qui dépasse l’esthétique n’est pas suffisante.
Il semble y avoir une difficulté à établir un pont entre analyse esthétique et analyse politique, ce qui rend difficile les échanges entre une cinéphilie pure et dure et des secteurs plus militants.
Vous avez raison et notre démarche vis-à-vis de la Cinémathèque l’a prouvé jusqu’à l’absurde. La difficulté vient de postures radicales qui refusent la discussion a priori, l’une purement esthétique de la part des organisateurs, et l’autre militante qui consiste à dire « il n’y a pas de débat à avoir parce qu’il n’y a pas de projection à avoir ». Tout le monde ne partage pas, du côté féministe, cette position. On aurait sans difficultés trouvé des points de vue différents pour un débat passionnant.
La Cinémathèque vous a-t-elle répondu ?
Pas du tout. Frédéric Bonnaud n’est évidemment pas tenu de nous répondre, mais on peut déplorer ce silence alors que la Cinémathèque elle-même, dès lors qu’elle a décidé de programmer le film sans rien organiser autour, s’était tiré une balle dans le pied. Il était évident que tout cela aboutirait à une déprogrammation, décision que la Cinémathèque a prise pour des raisons que je n’ai pas très bien comprises, d’ailleurs, de sécurité, comme si les féministes étaient de dangereuses agitatrices…
Plus généralement, quels critères relatifs à un film font à vos yeux que sa projection exige un débat? Est-ce lié à des réactions extérieures ?
Organiser des débats existe déjà, pour un tas de raisons: faire venir l’équipe racontant la genèse, pour des raisons esthétiques ou militantes. Du côté militant, je l’ai souvent constaté, il y a peut-être eu un glissement qui a fait que l’on s’est habitué à organiser des séances sur des documentaires uniquement autour de leur sujet, donc à dissocier le politique de l’esthétique, ce qui est dommage : je suis convaincue que la forme est politique. Aider le public à comprendre l’œuvre et la façon dont elle est faite l’aide aussi à réfléchir la question militante. Parler aussi d’hors-champ, de travellings, dont on sait qu’ils posent des questions éthiques au cinéma, serait plus enrichissant pour tout le monde.
Pensez-vous que le mot « censure » a pris aujourd’hui un sens nouveau, ou qu’il est utilisé de manière abusive ?
En tant qu’intervenante à l’université depuis plusieurs années, je remarque qu’aujourd’hui la censure est en partie considérée comme souhaitable, alors qu’avant, tous les progressistes étaient d’accord pour lutter contre. Actuellement, quand vous demandez à un panel de gens, y compris ceux qui travaillent dans la culture, quelles raisons légitiment la censure,comme je l’ai souvent fait en cours et en formation continue, ils trouvent tous une « bonne » raison, qu’elle soit féministe, religieuse, politique, historique… Le mot est rejeté par les associations progressistes qui disent: « la censure est l’apanage de l’État, nous, on demande l’annulation. » Mais cette pression pour que l’œuvre ne soit pas montrée, c’est de l’entrave, nouvelle forme de censure.
Pour le cinéma, n’importe qui peut voir le film ailleurs, en raison de la reproductibilité technique des copies, ce qui amoindrit la gravité de la demande d’annuler une projection.
Cette objection ne marche pas, parce que certes, un tableau est une œuvre unique, mais interrompre ou rendre impossible une séance de cinéma reste de l’entrave à la diffusion. À l’Observatoire, nous sommes d’ailleurs en train de travailler à cette question du délit d’entrave et de ses conditions avec les sénatrices qui sont à l’origine de la loi de 2016. Cette loi que l’Observatoire a contribué à forger est très importante car elle protège la liberté de création et de diffusion des œuvres ; elle a introduit le délit d’entrave dans le code pénal. Les atteintes aux œuvres se sont démultipliées, du simple courrier d’une association à un programmateur public dépendant d’un maire qui fait obstacle, ou encore au vandalisme. Au cinéma, c’est dur de vandaliser les copies, mais en art contemporain, c’est presque un sport.
Un des reproches faits à la Cinémathèque serait qu’en projetant Le Dernier Tango elle lui accorde une « place d’honneur ».
Il faut relire les statuts de la Cinémathèque : elle est censée acquérir tous les films qui marquent l’histoire du cinéma, or les critères, c’est une question toujours discutable. Est-ce que la Cinémathèque revendique de diffuser les films mauvais ou mineurs? Elle joue elle-même le jeu de l’institutionnalisation, dans la manière dont elle présente sa programmation. Mais de façon plus générale, ce n’est pas parce que l’on montre qu’on approuve ou que l’on honore. Cette distinction est essentielle, on devrait y revenir, et montrer des films aussi pour leur aspect problématique, y compris esthétique.
Cette question de la place d’honneur s’est posée pour la rétrospective Roman Polanski.
La différence est que Polanski est vivant et était invité en personne. Mais je suis gênée par cet argument de l’honneur: certes, tout le monde a envie d’avoir une rétrospective à la Cinémathèque, mais cela ne suffit pas à disqualifier la projection.
Pensez-vous qu’il importe encore de faire la distinction entre l’œuvre et l’auteur, distinction désormais souvent moquée pour pointer la mauvaise foi des partisans d’une « politique des auteurs » légitimant des abus ?
Pour répondre à cette question, je me permets de citer ce que j’avais écrit dans les pages du Monde: « Prétendre que le même corps filme et viole, c’est l’argument déjà utilisé par certaines féministes contre le J’accuse de Polanski, pour en demander la déprogrammation. Or, il ne vaudrait que si l’œuvre montrait le crime dont l’auteur est accusé, et alors en effet sa diffusion serait très discutable. En dehors de cette hypothèse, chacun doit pouvoir juger s’il est opportun, pour soi, de voir les films des auteurs mis en cause. Enfin, les déviances de certains ne doivent certainement pas abolir de façon générale la distinction entre l’auteur et l’œuvre, nécessaire pour lutter contre la censure ou l’entrave à la diffusion des œuvres.² »
¹ «Manifeste de l’Observatoire de la liberté de création» (28/02/2003) disponible sur le site de la Ligue des droits de l’Homme, ldh-France.org.
² Tribune parue dans Le Monde (30/03/2024) et reproduite sur le site de la LDH, ldh-France.org.
Entretien réalisé par Fernando Ganzo, Charlotte Garson et Marcos Uzal par téléphone, le 14 janvier

Actualités, Critique
De mal en pigeon
Aimer perdre de Harpo Guit, Lenny Guit (2025)
« Comment soigner » sont les mots qu’inscrit Armande, l’anti-héroïne d’Aimer perdre, dans la barre de recherche. Vif d’esprit, Google suggère la suite. Comment soigner quoi ? Une angine ? Un panaris ? Non : un pigeon. Celui qu’elle a recueilli alors qu’il stagnait au milieu de la route, placide, dépressif. Les noms de petits bobos s’affichant à l’écran éclairent tout de même l’allégorie : qui veut sauver autrui se retrouve surtout devant ses propres plaies, ses propres tares. Et l’oiseau de personnifier un double évident de la protagoniste – si évident que son nom complet est Armande Pigeon.
Harpo et Lenny Guit n’ont pas peur d’être littéraux, leur cinéma étant branché à un cerveau comico-épileptique qui se moque bien, à raison, de jouer au fin psychologue. Pas plus qu’ils n’ont peur de tirer sur des ficelles usées par d’autres – tels que les frères Safdie, influence revendiquée dont semble provenir l’ossature du récit. Combinarde bruxelloise vivant aux dépens des autres, parieuse fauchée et malchanceuse (logique), Armande croise le pigeon mais aussi Ronnie, sémillant échalas qui agit sur elle comme un portebonheur; formant un duo gagnant, ces flambeurs discount se jettent dans une frénétique virée nocturne entre casino et caniveau. Le pigeon convalescent comme métaphore du care que la joueuse néglige pour elle-même, en revanche, évoque moins les Safdie que Showing Up de Kelly Reichardt, où Michelle Williams soignait un colombidé. Influence bien plus lointaine, certes, mais Aimer perdre prolifère autour du même doute que suscite la lose au féminin chez Reichardt : de la baby-sitter pour animaux et de la société qui la regarde s’embourber dans ses problèmes, qui est le boulet ? Ce doute hante l’odyssée chancelante d’Armande, jalonnée d’enjeux prosaïques – lorsqu’on survit en comptant sur le hasard, le trivial est capital : un sandwich au camembert barboté dans un frigo se change en graal. Qu’il s’agisse de Catherine Ringer (logeuse maternelle au verbe haut), de Melvil Poupaud (noctambule cupide et crasseux comme pourrait en jouer Bouli Lanners) ou d’inconnus glanés dans le Bruxelles souterrain, les regards posés sur Armande sont duels. Tous trahissent un légitime agacement envers la tornade humaine qui joue de mauvais tours à son entourage ; en même temps, ils représentent l’austère jugement du destin qui s’abat injustement sur elle. Dès lors, le moteur qu’est la galère, déjà à l’œuvre dans Fils de plouc et réaffirmé ici comme système burlesque et motif obsessionnel (« C’est quoi, cette galère ? » est la première réplique), acquiert une dimension politique : la galérienne bouscule, salit, profite – mais la société en face fait pareil, comme ses ex et soupirants toujours prêts à monnayer en nature leurs dépannages.
La galère façon Guit ne suscite aucun apitoiement, mais une solidarité passant par une mise en scène accordée au défaut magnifique d’Armande : son énergie sourde et aveugle. Comme elle, Aimer perdre ne tient en place (modèle pour un cours de nu, elle est réprimandée car elle parle et frétille), tourne comiquement en rond (tels les aéromodélistes au nez en l’air, dont elle voudrait tirer profit), n’écoute rien des mises en garde (une comédie d’action aussi pauvre que l’héroïne : risqué, mais les auteurs tentent leur chance eux aussi) afin de mieux foncer bille en tête par-delà les conventions, avec le même regard de taureau que l’actrice Maria Cavalier-Bazan, révélation électrique dont la grâce hypernerveuse tranche finalement avec l’oiseau apathique du début. Avec ses lorgnades foudroyant autrui par en dessous, Maria/Armande se rend aimable et haïssable, gagnante et perdante, arnaqueuse arnaquée, si bien qu’elle brouille le regard : allez savoir qui est la vraie, le vrai pigeon(ne) de cette histoire.
Yal Sadat

Actualités
Sculpture et mémoire. Quatre films de Marguerite Duras
Sculpture et mémoire. Quatre films de Marguerite Duras de Suzanne Liandrat-Guigues
Presses universitaires de Rennes, « Épures », 2024.
Une incise, en gravure, est un motif ciselé dans la matière. Dans les films de Marguerite Duras, c’est la voix off qui tenterait d’inciser la surface, de se déposer sur le film et sur les sculptures qui apparaissent à l’image. Comme une entreprise de raccorder ou d’unifier les choses, en un oxymor vertigineux.
L’essai de Suzanne Liandrat-Guigues est une suite à son Cinéma et sculpture. Un aspect de la modernité des années soixante, paru en 2002. L’autrice reprend là où elle en était restée avec L’Année dernière à Marienbad d’Alain Resnais, Méditerranée de Jean-Daniel Pollet, Le Mépris et Une femme mariée de Jean-Luc Godard, pour sauter une décennie et s’attarder sur les quatre films de Marguerite Duras où apparaît la sculpture. Ceux-ci poussent l’idée cinématographique de la modernité à son comble dans cette disjonction du sonore et du visuel si caractéristique. Pour Liandrat-Guigues et « comme l’ambitionne Duras, il est souhaitable de faire entendre ou d’amener à penser cette disparition [du lien de l’homme avec le monde] au cours d’une expérience intérieure que peut favoriser le recours à la sculpture par son mutisme, sa densité, son obscurité ou sa friabilité et son effritement ».
Le trauma de la guerre se loge dans le travail cinématographique de l’écrivaine de la période 1976-1982, que Liandrat-Guigues met en relation directe avec la découverte des fameuses pages qu’elle avait rédigées plus jeune, retrouvées tardivement, et donnant son livre le plus saisissant : La Douleur (1985), d’après les souvenirs de son mari Robert Antelme, déporté en 1944. « La diversité des formes statuaires recrée, de film en film, ce que Douleur veut dire pour Duras. Sortant du rôle de décor ou de motif ornemental, la sculpture relève d’une “brocante” d’objets qui “sont doués d’éternité, de tristesse si vous voulez”, dit-elle. » En une écriture aussi dense que claire – là où les textes de Duras en voix off sont souvent lacunaires et implexes –, telle une enquête (parfois dans le noir d’un film – plans noirs ou passages assombris de Césarée – ou dans l’invisibilisation d’une sculpture – Le Navire Night), Liandrat-Guigues décèle des points d’achoppement ou, justement, de discordances, a priori irréconciliables entre bande image et bande son (dans Césarée ou Le Dialogue de Rome). Les films, difficilement prompts à se laisser cerner, s’ouvrent à l’analyse : ainsi, quand elle décrit, plan par plan, une obscurité et une statue abandonnée dans Son nom de Venise dans Calcutta désert, quatre pages font émerger les idées les plus sombres de l’Histoire : la torture, le four crématoire et l’allusion à la déesse Léthé qui « offre la coupe de l’oubli ».
Car Duras nous met face à un « double effondrement, matériel et mémoriel » du monde. Le livre invite à une fouille qui donne forme, biographie de Duras à l’appui, à cette « matière commune animée d’un continuel remuement » : dans cet ensemble de films, la sculpture est « l’autrement dit », la destruction, l’histoire du génocide juif et le « choix des sculptures variant les styles, les époques, les usages et les fonctions, est à l’image de la déportation démultipliée conçue par Duras ». L’écrivaine-cinéaste affirmait en 1982 : « Ce qui m’intéresse, c’est de faire entendre un texte accompli au cinéma. » (Le Monde extérieur. Outside 2.)
Ce court livre a le grand mérite de mieux faire entendre ses films, et de « faire consoner les inconciliables historiques dans cette communauté des souffrances ».
Philippe Fauvel

Actualités, Festival Cinélatino Rencontres de Toulouse, Festivals
À Toulouse, retour aux pays natals
FESTIVAL. Du 21 au 30 mars, la 37ᵉ édition de Cinélatino consacre un focus aux cinéastes issus des peuples originaires d’Amérique latine.
L’infatigable travail d’une poignée de festivals, parmi lesquels Brésil en mouvements depuis 2005 en Île-de-France et le Ciné Alter’Natif à Nantes depuis 2009, nous ont permis d’accompagner un changement de paradigme majeur de ce siècle: la naissance et le déploiement d’un cinéma réalisé par des cinéastes autochtones, le plus souvent au sein de leurs communautés respectives. Ces films déjouent, vengeance historique, le piège ethnographique qui fit trop souvent des mal nommés «Indiens» des objets filmés. Ils investissent le cinéma comme une forme expressive, dans la continuité des cosmovisions ancestrales des peuples en question, déboussolant les repères des cinéphiles.
La programmation « Regards et voix indigènes » conçue par le festival Cinélatino cette année s’approche de communautés autochtones situées au Mexique, au Chili, au Pérou, au Brésil et en Guyane française en huit longs métrages et une séance de courts. En traversant l’ensemble, un premier étonnement survient : comme l’espagnol et le portugais sont des idiomes lointains ! Dans Bajo sospecha : Zokunentu (2022), la voix de son réalisateur, Daniel Díaz Oyarzún, Mapuche chilien, ne manque pas de dire à ce sujet: « Aujourd’hui, la langue [le mapudungun, ndlr] est un chemin de reconstruction. Beaucoup d’entre nous n’ont nulle part où revenir, ni dans le temps, ni dans l’espace. Vivre une autre langue est la seule manière d’habiter cet immense dépouillement. » L’éloquence de la langue filmée vient ainsi susciter un territoire qui précède l’image. Elle soutient les liens communautaires au présent, tout en invitant à remonter les temporalités précoloniales. Les phonèmes imageants percent comme survivance indigène face au projet d’effacement sanguinaire mené au cours des processus de colonisation. Réhabiter la langue originelle, redonner un visage humain aux siens : ces deux mouvements vont de pair avec une clarté sagement colérique dans Bajo sospecha : Zokunentu. L’art du portrait filmé, dans la continuité des peintures de l’oncle du cinéaste, Bernardo Oyarzún, annihile la violence du délit de faciès dont les descendants de Mapuches sont encore les victimes, au cours de ratonnades policières ou par le racisme ordinaire. Deux titres de 2023 se centrent patiemment sur les élans d’une communauté : l’extraordinaire La Transformation de Canuto coréalisé par le cinéaste Mbyá Guarani Ariel Kuaray Ortega avec le réalisateur et anthropologue brésilien Ernesto de Carvalho (lire Cahiers nº 807) et Kinra de Marco Panatonic. Tourné presque intégralement en quechua, ce premier long métrage péruvien accompagne le déracinement d’Atoqcha, qui doit quitter son hameau montagneux pour suivre des études d’ingénierie dans la ville de Cuzco. Panatonic sculpte son film par un fort ancrage terrestre, exacerbé par des plans-séquences fixes qui honorent la durée des rituels. Ses personnages font sans cesse corps avec leur environnement, laissant émerger des bas-reliefs paysagers. S’il y a beauté du lieu, ce n’est pas par exaltation champêtre mais bien au nom d’un quotidien communautaire, dont la temporalité est guidée par les nuances saisonnières. Quand Atoqcha, récemment diplômé, décide de rentrer au village, se donne à entendre avec lui l’écho plus ample des horizons des cinémas autochtones d’Amérique latine : dans des sociétés empreintes de colonialité, la terre mère demeure le territoire d’avant, parlée en guarani ou aymara.
Claire Allouche

Actualités, Critique
L’Échappée belle
Au cœur de l’été, un van en panne force une poignée d’amis, petite troupe de comédiens et de musiciens, à attendre dans une maison de campagne. Dans ce temps libéré du pragmatisme: délassements solitaires, discussions et lectures au soleil, répétitions d’une mise en scène des Trois Sœurs de Tchékhov et multiples concerts improvisés, balades dans la campagne et le château non loin, dont le propriétaire fantasque a chargé son homme à tout faire, violoncelliste à ses heures, de trouver une durite de remplacement. Tourné entre les deux confinements, ce film chaleureux improvise ses microfictions croisées (que traversent aussi un poète mélancolique, des villageois pourvus d’étranges masques et un angelot enfant) dans un cénacle de fantaisie, en fixant ses plans-fenêtres pour les ouvrir tout grand aux respirations de ses personnages et à l’inspiration des correspondances poétiques, intellectuelles, linguistiques et musicales qui les entourent. Sur le modèle du petit ver du poète amateur de pêche à la ligne (« une éponge à odeur, tu peux le parfumer, il sent très bon »), ce cinéma artisanal de la proximité sensible et affective, attentif aux bruits et présences de ce qui vit tout près (le situationniste Raoul Vaneigem, hédoniste et libertaire, habitant du coin, est évoqué), cherche à qui et quoi s’aimanter intérieurement pour palier à l’immobilisme politique. Jusqu’à son final, où la célèbre chanson « Je survivrai », récrite, devient « Je la suivrai ».
Pierre Eugène

Actualités, Critique
The Insider de Steven Soderbergh
Londres, lit d’espions
Écrit par David Koepp, le scénariste de Presence, et tourné seulement deux mois après celui-ci, The Insider ressemble au premier abord à une concession commerciale, avec stars et visée divertissante, contrepoint aux recherches plus formelles de Steven Soderbergh sur les possibilités de la caméra et du numérique. La quête de fluidité et de pauvreté, dont le film de fantômes a été le réceptacle, laisse place à un montage heurté avec séquences à suspense et recomposition narrative lors d’un dévoilement final à la Agatha Christie. Même s’il se déroule essentiellement dans des bureaux impersonnels et des logements luxueux et interchangeables, le film d’espionnage révèle peu à peu sa frénésie ludique. Le principe est annoncé avec une efficacité proche de la parodie dès la première réplique (et le premier plan-séquence). Après avoir erré pour retrouver son informateur dans les méandres d’une boîte de nuit londonienne, George Woodhouse (Michael Fassbender) apprend l’invraisemblable vérité : « Il y a une taupe dans ton équipe, et ta femme est parmi les suspects. » S’ensuit un dîner dominical au cours duquel George arrose la viande d’une dose de penthotal et oblige les traîtres potentiels à jouer à une variante d’action/vérité à propos de leur vie sexuelle, dans l’espoir qu’ils livrent sans s’en rendre compte une information essentielle. La prédilection pour les secrets d’alcôve et leur déballage rapproche The Insider de la froideur analytique mise en place dès Sexe, mensonges et vidéo en 1989, dont Girlfriend Experience (2009) constituait le point culminant : raideur robotique des corps, lumières tamisées de l’intimité dévoilée, comportementalisme strict qui ne connaît qu’un choix entre l’habitude et le chaos, fascination pour la surface et hostilité à toute profondeur. Grâce à cette esthétique, Soderbergh a dégagé les enjeux transactionnels de la sexualité propres à l’économie de marché. La quête de vérité dont George se fait le héraut semble, dans un premier temps, aspirer à une humanité qui tournerait le dos au XXIᵉ siècle et accepterait une relative exhibition des sentiments. Les formes du contrôle se relâchent progressivement, du lapsus jusqu’à la panique burlesque, sans étrangement remettre en cause la manière dont le couple est pensé et organisé. Entre le début et la fin de The Insider, le rapport des forces à l’intérieur a évolué, mais la vie conjugale demeure une machine spéculaire, close sur elle-même comme un service secret. Ce passage de la sévérité à la farce correspond moins à une humanisation des affects et à une transformation des personnages qu’à une différence de vitesse. Plus Soderbergh s’arc-boute sur les conventions de ce prétexte narratif qu’est le McGuffin (ici, à cause du logiciel volé Severus, « des millions de personnes mourront »), plus il accélère, et mieux il en pointe le néant. Il cherche une forme d’expansion, d’explosion qui puisse faire s’agiter ces créatures unidimensionnelles. Entre l’énoncé du mystère et sa dissipation, une tache de sauce tomate sur la manche d’une chemise immaculée s’est transformée en giclée de sang sur un mur. Sommes-nous vraiment passés de presque rien à quelque chose ? The Insider abandonne la prétention conceptuelle de Presence tout en tournant, lui aussi, autour d’une inconsistance fondamentale. Lorsque George martèle qu’il « déteste le mensonge », il n’énonce pas une situation morale mais une ambition esthétique où l’on retrouve le cinéaste de The Informant! (2009) : celui d’une transparence qui ne serait pas construite par le désir ou l’intervention, seulement par l’état de retrait et d’accueil que permet le vide barométrique de la mise en scène.
Jean-Marie Samocki

Actualités
Au Micro Salon, du lien et de l’IA
IMAGE. Installé au Parc floral de Paris, le Micro Salon de l’Association française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique (AFC) a réuni pour la 25e année chefs opérateurs, fabricants et loueurs de matériel. Quelques jours avant le sommet de l’IA à Paris et son contre-sommet simultané, une table ronde a été organisée pour interroger les répercussions des avancées technologiques dans la création audiovisuelle.
C’est à la fois un sujet de préoccupation et un problème encore inexistant. Parmi la vingtaine de groupes de travail de l’AFC, il en est un exclusivement consacré à l’intelligence artificielle ; mais, pour Yves Cape, chef opérateur de Guillaume Nicloux, Cédric Kahn, Michel Franco ou Bruno Dumont et trésorier de l’association, « l’IA n’a pas encore généré d’outils de création susceptibles d’être utilisés sur les plateaux de tournage. Elle peut servir avec finesse à l’étalonnage, afin d’éviter des tâches fastidieuses, et éventuellement au moment de la préparation du film, pour se donner quelques idées et communiquer avec un réalisateur, mais c’est tout. Je ne suis pas très inquiet: on aura toujours besoin de travailler de concert avec un réalisateur, un chef décorateur et un chef costumier pour inventer un univers et émouvoir avec des images ».
En ce qui concerne l’IA générative, si à large échelle elle ne fait pas le poids face à l’originalité des visions d’artistes et à la subtilité des acteurs, se dessine néanmoins aujourd’hui, pour ceux qui choisissent de travailler avec elle, une manière singulière de créer, dotée de méthodes et d’enjeux propres. Ruser à coup de paraphrases dans les instructions textuelles (les « prompts ») données à la machine pour contourner la rigidité des restrictions, variables en fonction des moteurs de fabrication d’images, visant à limiter par exemple le gore ou la pornographie ; constituer sa propre base de données à partir de laquelle l’ordinateur génère des images, afin d’éviter les multiples biais imposés par les datasets préconstitués; inventer ses modèles ou programmes, c’est-à-dire déterminer la manière dont l’IA répond aux demandes; choisir et monter, si l’on reste dans le domaine de l’image animée, les plans ainsi obtenus : comme dans n’importe quel autre processus de création, alors qu’on pourrait croire que tout devient à la fois possible et formaté, l’artiste se confronte avec l’IA à un ensemble de contraintes autant qu’il jouit d’une certaine marge de manœuvre.
Au-delà des innovations – l’IA peut désormais, par exemple, générer des images à partir de photographies ou de plans existants –, les interrogations les plus brûlantes sont d’ordre juridique. Lucie Walker, juriste de la postproduction, explique : « Il y a encore quelques mois, le bureau du copyright américain considérait qu’une œuvre, pour être protégée par le droit d’auteur, devait être intégralement créée par l’artiste lui-même. Les choses évoluent en ce moment : il y une dizaine de jours, un rapport de ce même bureau a établi qu’un prompt isolé relevait du domaine des idées, non protégeable, mais qu’une combinaison de prompts pouvait donner lieu à une œuvre originale si l’on parvenait à démontrer la part de créativité humaine nécessaire pour l’obtenir. Cette position sera progressivement adoptée ailleurs, notamment en France. » En plus de la paternité des œuvres, pose également question, de façon plus diffuse, la nature souvent obscure des données constitutives des datasets : rien ne vient garantir qu’elles sont libres de droits, au point de limiter l’usage de l’IA par les grands studios d’effets spéciaux et les plateformes, qui craignent de perdre la propriété de l’œuvre. Si l’on comprend que les cartes sont rebattues sans cesse, les freins à l’usage de l’IA générative sont ainsi autant juridiques que techniques et culturels – le réel, qu’elle nappe d’une inquiétante artificialité, lui résiste, et «on aura toujours besoin d’admirer des acteurs en chair et en os, de se relier à l’humain grâce au cinéma», comme le formule Vincent Mathias, directeur de la photographie. À terme, on peut penser que l’IA générative menace moins le cinéma et les chefs de poste que les petites mains dont les tâches sont progressivement automatisées, ainsi que le milieu plus standardisé de la publicité.
Mathilde Grasset

Actualités
Emilie Dequenne à propos de Rosetta
HOMMAGE. À l’annonce de la disparition d’Émilie Dequenne, nous partageons ses propos tenus à la sortie de Rosetta dans les Cahiers d’octobre 1999 (Cahiers nº 539).
Je me suis construit l’histoire de Rosetta petit à petit, dans ma tête, et sans en parler à personne j’imaginais que sa mère l’avait eue très jeune, que le père était parti. Sa mère l’avait élevée, seule, et, très vite, Rosetta était devenue la mère de sa mère. J’interprétais ses maux de ventre comme une traduction physique du manque de père, la chaleur et la tendresse qu’elle n’avait pas connues.
Je n’ai pas beaucoup préparé mon rôle, j’ai attendu de la connaître, d’en parler avec les frères. Il ne faut pas trop réfléchir avec un personnage qui est si vrai. J’ai été très effrayée à la lecture du scénario car le rôle est si réel qu’on se dit qu’on ne peut pas le jouer, seulement le vivre. Je ne voyais pas les rushes. C’était un choix des frères, et je leur faisais confiance. Si je m’étais vue, j’aurais peut-être cherché à modifier certaines choses qu’ils ne voulaient pas voir changées. Le fait de ne pas rentrer chez moi pendant tout le tournage m’a aidée à rester dans l’univers de Rosetta, ainsi que les costumes. Mais je n’étais Rosetta qu’à partir de « Moteur ! ». J’essayais de vivre les situations, et de découvrir les choses en même temps qu’elle. Je n’avais aucun mal à m’en défaire à la fin de la journée. J’avais, comme elle, mon petit rituel en rentrant à l’hôtel : j’enlevais mes chaussures, je faisais couler un bain, et j’appelais ma mère en lui demandant de parler d’autre chose.
Les scènes où il faut parler, faire des choses lentes ou ne rien faire du tout, sont celles qui m’ont le plus pesé. Je préférais de loin les scènes physiques : courir, se bagarrer… J’aime les rôles féminins physiques, Anne Parillaud dans Nikita, Emily Watson dans Breaking the Waves, ou encore l’actrice Cameron Diaz, qui n’hésite pas à jouer de son corps, à se rouler par terre, à aller à l’encontre de sa beauté. Les rôles intérieurs, sombres, m’attirent également. Je ne suis pas très machiavélique, et j’aimerais jouer des psychopathes, des névrosées. J’ai vu Les Griffes de la nuit à l’âge de huit ans. Traumatisée, j’ai plus tard décidé de surmonter cette peur en me confrontant, toute une soirée, seule chez moi, à une pile de cassettes vidéo de films d’horreur. Tout était normal en me réveillant le lendemain matin. Tout cela n’était que du cinéma.
Propos recueillis à Paris, le 1er septembre 1999, par Clélia Cohen et Jérôme Larcher.

Actualités, Festival International du court métrage de Clermont-Ferrand, Festivals
Clermont-Ferrand, à feu et à sang
FESTIVAL. Offerte comme un « portrait mouvant du monde» et de son lot de cauchemars, la 47e édition du Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand a laissé une large place à l’expression d’une colère explosive et d’une violence en basse continue.
Le somptueux film d’animation en peinture à l’huile de Florence Miailhe, Papillon, fait glisser sur une toile vernie le nageur juif algérien Alfred Nakache, de la Méditerranée aux piscines olympiques, jusqu’au camp nazi où il a été déporté. À l’image de ces imbrications de traits et de couleurs, de cette fluidité aqueuse, nombre de films ont montré une violence fondue, non diluée mais cruellement intégrée au quotidien des personnages, à leur imaginaire, et régulièrement enceinte d’une forme d’humour larvé. Violence de la guerre au Liban dans Et s’ils bombardaient ici ce soir? (Samir Syriani), où un couple pragmatique disserte sur le meilleur emplacement de son lit pour éviter de recevoir, en cas d’explosion, des éclats de verre ; violence économique de l’Angleterre postBrexit dans Rhubarbe, rhubarbe (Kate McMullen), qui oppose en des plans répétitifs et de plus en plus courts la culture nocturne, empreinte de magie, de ces plantes éclairées à la bougie, et la cadence agressive du trafic routier, tonitruant, voisin de cette petite exploitation agricole en manque de main-d’œuvre. Comme un pendant aux fictions des autres sélections, la compétition Labo réunit des films « au croisement de différentes disciplines artistiques, mélangeant les genres, sortant de la sacro-sainte narration, allant chatouiller l’art vidéo», comme la présente Calmin Borel, qui la coordonne depuis sa création en 2000. Elle permet aujourd’hui à la dystopie de venir griffer l’image de manière frontale, quitte à la faire exploser.
Dans La Théorie de l’égrégore, le souvenir de La Jetée de Marker est égratigné par l’intelligence artificielle avec laquelle ont été fabriquées les images du film d’Andrea Gatopoulos : tandis qu’une voix off raconte une épidémie de morts brutales causées par la lecture ou la prononciation de certains mots inconnus, des images immobiles en noir et blanc défilent, intégrant des bouts d’éléments identifiables (bâtiments, visages) et d’autres aux contours indistincts, à l’artificialité diffuse et d’autant plus cauchemardesque. Conçu en animation 3D à partir d’un logiciel de création de jeux vidéo, La Fille qui explose du duo Caroline Poggi et Jonathan Vinel donne au mal-être de son personnage la forme de désintégrations littérales et répétitives, d’un corps certes immortel mais aussi composite, boyaux sortis et bouche cousue, d’une vie ruinée sans game over, là encore rythmée par une voix off à la première personne, calme, faite d’une suite d’aphorismes sur une colère contemporaine, un général « attentat au bonheur». Club Bunker des artistes M+M (Marc Weis et Martin De Mattia), conçu comme le second volet d’une trilogie inaugurée par Mad Locataire (sélectionné à ClermontFerrand en 2019), étouffe ces voix humaines en déléguant à d’autres figures, silencieuses, un même pouvoir d’inquiétude. Des mantes religieuses et des phasmes sont filmés par une caméra 3D macroscopique dans un décor miniature aux murs tagués, glauque et abandonné. Divisé par six fondus au noir comme de lents battements de paupières, le film parvient à faire du comportement et de la mobilité des insectes les manifestations d’un état second où se côtoient, dans l’amalgame des espèces, la sexualité et la cruauté. Leur vie de mantes et de phasmes pleinement retrouvée à la fin du film, au cœur d’une forêt, a priori libérée de l’analogie, émeut autant qu’elle fait encore craindre une rixe, une guerre des gangs. Comme dans Who Loves the Sun d’Arshia Shakiba, où la dense fumée noire d’une raffinerie de pétrole vient lécher l’écran et faire palpiter la pollution comme une créature autonome, l’humain s’insinue, même absent, là où persiste une forme ou une autre d’agression.
Mathilde Grasset

Actualités, Critique
The Last Showgirl
The Last Showgirl s’inscrit dans la lignée de films récents (The Substance, Babygirl, Maria) qui explorent d’autres régimes d’iconisation, voire de ré-iconisation, en prenant en compte frontalement l’âge, la carrière plus ou moins erratique, ou les transformations physiques de leur actrice. En choisissant Pamela Anderson, Gia Coppola donne également une portée éthique à son geste: il ne s’agit pas seulement de glamouriser différemment ou de sortir de l’oubli une star, mais d’offrir une dignité d’artiste à une professionnelle dont le talent n’a pas été célébré. Une scène de casting ouvre le film comme une vidéo promotionnelle destinée à la réhabiliter, et le personnage de Shelly dessine une forme d’autoportrait: son numéro à Las Vegas n’est peutêtre pas du grand art, mais la showgirl tient à le faire bien, avec cœur et jusqu’au bout, alors qu’elle apprend la fermeture de son club. L’éloge tourne cependant court.
Coppola n’exploite jamais la dimension spectaculaire de son sujet. En privilégiant le gros plan, elle contourne systématiquement les scènes de danse et empêche le jeu d’Anderson de se déployer, malgré son omniprésence à l’image, trop peu attentive en vérité à ses gestes ou à ses regards. La cinéaste se concentre sur des à-côtés qui remplissent artificiellement l’ensemble : scènes de mélodrame sans tension, instants documentaires tout juste esquissés en caméra à l’épaule, déplacements dans la ville abstraits et filmés en contrejour façon clip. Quant à l’élégie, comme la cruauté est laissée de côté, la poétisation des corps par des jeux de strass ou de lumière condamne les chairs à se déréaliser dans un ersatz de féérie.
Jean-Marie Samocki

13 mars 2025 à 15:00
Ce qu’il reste à espérer
EXPOSITION. Après l’herbier de Sept promenades avec Mark Brown, Pierre Creton et Vincent Barré proposent une nouvelle balade, à Yvetot puis à Fécamp, où brille le goût du détail.
© Salim SANTA LUCIA Vue de l’exposition EX-VOTO à la galerie Duchamp Yvetot. Œuvres de Vincent Barré © ADAGP, Paris, 2025 ; de Pierre Creton et des élèves de l’école municipale d’arts plastiques de la Ville d’Yvetot.
Vattetot et Va, Toto ! riment avec Ex-Voto : nom de ville, titres de film ou d’exposition se mêlent et forment une ritournelle lancinante. En traversant la galerie Duchamp d’Yvetot, cet air tout droit tiré de notre imagination nous entête davantage. Après la sortie en salles en janvier dernier de leur sublime Sept promenades avec Mark Brown, Vincent Barré et Pierre Creton nous content encore fleurette. Mais la chansonnette qu’on s’invente est-elle une comptine ou une antienne ? Figure de la prière, de la réparation, de la protection, de l’attente ou du désir, l’ex-voto est un objet intimement façonné, ou une image soigneusement choisie, d’emblée « chargé d’affect », selon les mots de Creton. Avec un ex-voto, il y a vœu, offrande, remerciement pour un acte de guérison. À un dieu, à un fantôme ou à une personne bien vivante, à une situation, il y a oblation ou don, afin de rendre grâce pour une vie saine et sauve.
Les ex-voto sont chargés d’une histoire, d’expériences de vie. Le grand nombre d’œuvres présentées ici renvoie à autant de récits singuliers, et leur mise en espace dans la galerie est comme un bois essarté de la main (organe partout représenté ici) : un ensemble morcelé de formes très diverses – dessins, sculptures, photographies, vidéos –, parsemées comme les fragments d’un journal qui amasserait « les espérances accomplies et ce qu’il reste à espérer», et qui « interdit tout repentir». Il n’y a pas de cartel dans l’exposition, et les travaux des deux artistes se confondent avec ceux d’invités, proches ou moins proches, élèves, jeunes et moins jeunes, qui viennent prendre des cours dans le centre d’art où Creton enseigne. Notre ritournelle tourne alors au marabout (le jeu) et se télescope avec l’idée de rebouteux ou de guérisseur…
© Salim SANTA LUCIA Vue de l’exposition EX-VOTO à la galerie Duchamp Yvetot. Œuvres de Vincent Barré © ADAGP, Paris, 2025 ; de Pierre Creton et des élèves de l’école municipale d’arts plastiques de la Ville d’Yvetot.
Toutes ces formes font ex-voto dans l’exposition, y compris le disque vinyle du Pierrot lunaire, accroché comme une « lune noire », une « lune malade » qui accompagne la projection de Simon, at the Crack of Dawn, film coréalisé en 2016 à propos d’un boulanger d’origine ivoirienne. Saint Roch, patron des chirurgiens et des boulangers (souvent représenté un chien à ses côtés, qui lui porte du pain alors qu’il est atteint de la peste et s’est réfugié dans les bois), devient allégorique alors, avec ces Boîtes de secours en bois au mur, ces grosses miches posées les unes sur les autres et ces Cretons de pain de fin de repas, croûtons secs conservés comme « des reliques » et coulés en bronze. « Les visiteurs à ma table pensent à des pattes d’animaux », écrit Creton en légende ; on y voit – suite de notre ritournelle sans queue ni tête – deux sexes masculins collés l’un à l’autre, comme une résurgence figée d’Un prince.
Des figures protectrices – outre saint Roch, Kafka et Bataille, et beaucoup d’autres noms, connus ou méconnus, écrits au stylo Bic sur des listes encadrées –, on retiendra Lynch, dont le livre L’Espace du rêve est protégé par le verre, coupé à sa taille, d’une serre de Creton détruite par la tempête Ciarán en novembre 2023. Deux bûches sont exposées : une nommée « Robert », l’autre « Madeleine », qui vient de chez son amie Ghislaine : « J’ai vu cette bûche de charme étrange qui m’a fait penser à celle de la Log Lady [« la femme à la bûche » de Twin Peaks, ndlr.] et qui pourtant n’a rien à voir. Je lui ai demandé (je ne l’ai pas volée) si je pouvais l’emporter. Je suis rentré sous la neige, avec elle sous le bras.» Quelle plus parfaite figure de l’objet votif, du sujet aimé ?
Philippe Fauvel
© Salim SANTA LUCIA Vue de l’exposition EX-VOTO à la galerie Duchamp Yvetot. Œuvres de Vincent Barré © ADAGP, Paris, 2025 ; de Pierre Creton et des élèves de l’école municipale d’arts plastiques de la Ville d’Yvetot.
Ex-Voto, jusqu’au 13 avril à la galerie Duchamp à Yvetot.
Ex-Voto, figures du soin, du 8 mars au 31 août au Musée des pêcheries de Fécamp.
VINCENT BARRÉ – PIERRE CRETON
Anciens Numéros